Accueil > Controverses pédagogiques > L’école et les savoirs. A propos d’un ouvrage d’Astolfi
 L’école et les savoirs. A propos d’un ouvrage d’Astolfi
L’école et les savoirs. A propos d’un ouvrage d’Astolfi
vendredi 1er juin 2012, par
La Saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d’apprendre, est le dernier ouvrage de Jean-Pierre Astolfi, didacticien des sciences et enseignant en sciences de l’éducation, décédé en 2009. [1] L’auteur fut salué lors de sa disparition comme un membre éminent de sa communauté universitaire, et plus largement de la noosphère pédagogique. « C’est le meilleur d’entre nous » dira l’un de ses pairs à cette occasion, et l’on voit bien qu’il ne s’agit pas d’un hommage de pure forme. [2] Sans doute reconnaît-on ainsi tant l’intelligence, la finesse d’analyse et la clarté d’exposition de ses travaux, que sa capacité à représenter l’unité des sciences de l’éducation. Bachelardien, Astolfi reste en effet particulièrement attentif aux thèses pédagogiques contemporaines, et n’a de cesse d’associer le principe de la rupture épistémologique et le principe constructiviste. C’était « le plus pédagogue des didacticiens » dira-t-on encore de lui à l’heure des regrets posthumes. N’a-t-il pas été président du CRAP de 1978 à 1980, rédacteur en chef des Cahiers Pédagogiques de 1981 à 1984, membre du comité de rédaction de la revue de 1972 à 2000 ?
Non seulement il participe ainsi très activement à l’organisation de la communauté psychopédagogique, mais il appartient aussi pleinement à son univers culturel, manifestant une connaissance très précise des travaux de ses collègues où il puise, de façon toujours positive et assez exclusive, l’essentiel de ses références théoriques [3].
Sur la dizaine de livres qu’il a publiés, La Saveur des savoirs pourrait faire figure de legs intellectuel, présentant un tableau d’ensemble de convictions forgées au long de quatre décennies de recherches.
L’ouvrage mérite ainsi une attention particulière par ce qu’il peut nous apprendre du meilleur des connaissances produites par les sciences de l’éducation, sur la ligne de crête des deux versants, didactique et pédagogique, de cette spécialité universitaire.
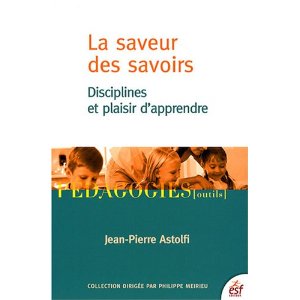
L’appropriation des savoirs disciplinaires, mission fondamentale de l’école
Astolfi est de ceux pour qui la mission première de l’école est de transmettre les savoirs au grand nombre. S’il appelle au « recentrage sur les savoirs » (p. 14), il n’y a rien pour lui dans cet objectif d’inévitablement élitiste, et il s’affirme fermement en faveur d’une « formation intellectuelle à la fois exigeante et démocratisante » (p. 11).
Un enseignement de qualité ne saurait avoir d’autre ambition que d’introduire les élèves aux disciplines, qui seules ont développé et développent des savoirs « dignes de ce nom » (p. 16). Car c’est en leur sein que se construisent les connaissances qui rompent avec le sens commun, et à quoi servirait d’aller à l’école si ce n’était pour s’ouvrir à de telles connaissances ? Les disciplines sont comme des géants qu’ont fait grandir les générations précédentes et sur les épaules desquels il faut commencer par se hisser pour voir plus loin. « Sans les ressources des disciplines, nous raisonnons au ras du sol » (p.17).
Les connaissances ne sont pas empiriquement données mais historiquement construites, insiste Astolfi, Bachelard à l’appui. Elles sont conquises contre les apparences grâce à l’élaboration d’un point de vue particulier sur l’objet, qui est l’œuvre, en forme de concepts et de questionnements, des chercheurs de la discipline. Celle-ci ne se définit pas par son objet empirique, mais par un cadrage théorique original : c’est ce point de vue disciplinaire sur le monde que l’école doit inviter ses publics à s’approprier, secteur par secteur de la connaissance.
Il n’y a pas d’autre voie pour la formation des jeunes générations, pas de raccourci possible. Prétendre, par souci d’efficacité, les mener directement à l’acquisition de compétences intellectuelles supra disciplinaires est illusoire. Les élèves peuvent investir dans l’appropriation des disciplines des compétences cognitives générales (raisonner, réfléchir, abstraire), mais l’accès aux compétences cognitives développées et complexes, telles celles qu’Edgar Morin propose comme objectif à l’éducation (maîtriser l’incertitude, les principes d’une connaissance pertinente, etc.), suppose le détour par le conceptuel, et donc par le disciplinaire.
« Ce qui manque le plus aux élèves, ce n’est pas tant l’ouverture interdisciplinaire qu’une disciplinarisation préalable de leur esprit » (p. 111). En ce sens, former de réelles compétences, c’est développer l’appropriation disciplinaire des savoirs jusqu’à la rendre opératoire pour les intéressés. Un enseignement qui se voudrait interdisciplinaire, transversal, une pédagogie du global avant l’heure, risquerait de « détricoter » tout l’effort de construction disciplinaire pour échapper au sens commun : autre chose étant le croisement « sans naïveté épistémologique », sur des objets empiriques, d’apports disciplinaires bien maîtrisés.
Une posture constructiviste assumée et ouverte
Astolfi s’affirme pleinement constructiviste, mais sans naïveté. Sans oublier, en particulier, la première des trois acceptions possibles du terme, le constructivisme épistémologique. Pour ce dernier, la connaissance se construit non par la soumission aux faits, mais par l’investigation théorique : la transmettre, c’est permettre l’appropriation des questions qu’elle pose plutôt que les connaissances qu’elle produit.
Le second registre auquel cette notion s’applique est celui des apprentissages cognitifs, qui s’opèrent par remaniement des représentations préexistantes, chaque élève apprenant en fonction de ce qu’il est en mesure d’assimiler, de façon imprévisible pour l’enseignant.
Le troisième registre est celui du constructivisme pédagogique, selon lequel on ne peut conduire la pensée des élèves en leur lieu et place, on ne peut que construire des situations didactiques et des dispositifs d’apprentissage correspondant à chaque objet d’enseignement.
Astolfi n’ignore pas que la pédagogie constructiviste effectivement pratiquée dans notre système éducatif n’a pas toujours produit des résultats très satisfaisants. C’est que le principe constructiviste implique une « ingénierie didactique » complexe, délicate à concevoir et à mettre en œuvre, qui doit à la fois mobiliser les élèves et être adéquate à l’objectif cognitif visé. Or cette adéquation est loin d’être toujours assurée, les exigences cognitives étant sacrifiées au souci de mobilisation des élèves ; et la rénovation pédagogique devient « une vulgate qui n’a de constructiviste que le nom » (p. 137).
Il reste que « le constructivisme en éducation ne devrait pas faire discussion dans son principe » (p. 132). Il exige cependant une pratique intelligente, qui se permette par exemple sur certains objets d’enseignement de faire sa place au cours magistral, à condition que celui-ci sache historiciser et problématiser les connaissances à transmettre, et respecte ainsi le constructivisme épistémologique. A condition aussi de ne pas oublier que les élèves en difficulté, qu’on cherche à protéger du choc culturel, ont pourtant besoin de comprendre les objectifs cognitifs visés, d’identifier les savoirs en jeu.
Une critique des « dérives » du constructivisme
S’il doit être conforme au principe constructiviste, l’enseignement n’en doit pas moins rester fermement centré sur les savoirs. Astolfi marque en ce sens, à plusieurs reprises, ses distances avec la « vulgate », la « fausse monnaie constructiviste », qui met l’élève au centre pour mieux en évacuer les savoirs.
Cette dérive emprunte, à son sens, plusieurs canaux. Celui de la psychologisation de l’erreur : plutôt que de s’attacher à en décrypter la « logique interne » (p. 42) et le processus proprement intellectuel, l’enseignant en fait une « faute » procédant d’un manque d’attention, de travail, de compétence… Celui aussi du psychologisme de la « motivation », qui impute la difficulté d’apprentissage au manque de « motivation ». Or, fait observer Astolfi, la motivation ne saurait précéder l’apprentissage : on n’est pas motivé pour apprendre « en général », on est motivé par ce qu’on vous propose d’apprendre. La motivation ne doit donc pas être considérée comme un préalable mais comme « un effet attendu de la réussite pédagogique » (p. 68). Et la motivation dont les apprentissages scolaires ont besoin, ce n’est pas la motivation extrinsèque qui s’attache à leurs bénéfices attendus (réussir ses examens, son métier, sa vie), mais la motivation intrinsèque qui tient au plaisir de l’activité de connaissance considérée en elle-même.
Autre canal encore de la dérive constructiviste, la rhétorique disqualifiante de « l’élève en difficulté », qui procède le plus souvent d’un fatalisme du handicap socioculturel auquel Astolfi refuse toute pertinence. Voir les élèves comme des élèves-en-difficulté qui manquent de bases, qui n’ont pas les prérequis nécessaires, c’est s’interdire d’interroger la réalité de leurs acquis, à partir desquels l’enseignant peut concevoir et conduire les apprentissages.
La différenciation pédagogique peut elle-même participer à la dérive constructiviste. Si Astolfi admet son principe – face à l’hétérogénéité des élèves mieux vaut à son sens la pédagogie différenciée qu’une pédagogie de « soutien » qui permet de maintenir un enseignement de type traditionnel – elle conduit trop souvent à « adapter les exigences aux possibilités de chacun », et dès lors à « en rabattre sur les exigences intellectuelles au nom du réalisme pédagogique » (p. 15).
Les conditions d’un enseignement efficace
Par nature, parce quelle implique une rupture avec le sens commun, qu’elle doit être conquise contre les apparences du monde vécu, l’appropriation des savoirs disciplinaires est une entreprise toujours difficile. Apprendre est coûteux pour des élèves qui ne peuvent pas voir le terme du voyage avant de s’y engager. Apprendre ne va jamais de soi. L’insistance d’Astolfi à rappeler ce point de départ essentiel de l’entreprise pédagogique n’est certainement pas superflue, tant celle-ci est vouée à l’échec si elle renonce à confronter les élèves à la difficulté intellectuelle.
Pour conduire cette confrontation, les enseignants peuvent tabler sur les ressources et les acquis des élèves, à condition de ne pas voir seulement chez eux ce qui fait défaut. A condition, tout aussi bien, d’affirmer clairement que le seul ressort possible des apprentissages ne peut être que le plaisir d’apprendre. A condition encore, dès lors, de rendre les élèves sensibles à « l’appel des savoirs », et donc de « redonner des couleurs à la connaissance » (p. 122), en les introduisant à l’histoire et à l’épistémologie des disciplines, sans en rester à leur face académique. A condition enfin de ne pas reculer devant l’obstacle et sacrifier la connaissance quand c’est difficile. Il faut « élémenter » le savoir plutôt que de l’abréger, note Astolfi à cet égard, invitant ainsi à maintenir l’ambition intellectuelle en conduisant les élèves aux fondements conceptuels des savoirs visés plutôt qu’en leur en proposant des rudiments de connaissance prédigérés.
Les enseignants ont évidemment besoin d’une formation adéquate pour être en mesure de satisfaire ces conditions d’un enseignement efficace. Ils ne peuvent rendre vivants et attractifs pour les élèves les savoirs de leur discipline que si ces derniers constituent pour eux-mêmes des savoirs vivants, problématisés, en recherche. Il convient donc de concevoir une formation professionnelle très solidement disciplinaire, qui assure aux futurs maîtres une maîtrise suffisante non seulement des connaissances produites par leur discipline mais aussi de l’histoire, de l’épistémologie, de la didactique de ces savoirs.
La conduite des apprentissages
Les principes de la conduite des apprentissages ne sont pas des recettes qu’il suffirait d’appliquer. L’exigence de maîtrise disciplinaire s’impose d’autant plus que l’enseignant doit être en mesure de réfléchir à chaque moment les processus cognitifs en cours chez ses élèves, d’interroger la logique de leurs erreurs et de comprendre pourquoi ils ne comprennent pas. Ils doivent à cet égard se défier des automatismes de l’enseignement magistral, et Astolfi recommande de ne jamais caler à l’avance une séquence d’enseignement, car les chemins de l’apprentissage défient les prévisions.
Mais toute forme d’enseignement magistral n’est pas à proscrire pour autant. Car cette même capacité à prendre une distance réfléchie par rapport à ce qui se joue dans la classe peut amener l’enseignant à privilégier à tel ou tel moment une intervention magistrale imprégnée de constructivisme épistémologique, en abandonnant la posture du constructivisme pédagogique : notamment lorsqu’il perçoit que les « élèves en difficulté » ont besoin d’une claire désignation des enjeux de savoir.
Astolfi recommande aux enseignants, dans cette perspective, de penser leurs objectifs pédagogiques en termes d’« objectifs-obstacles », qui permettent de passer du « ce que l’élève doit être capable de réussir » au « ce que l’élève est en état de réussir » : non pas pour en rabattre sur l’ambition des objectifs, mais pour les définir comme des objectifs de transformation des représentations des élèves et analyser les obstacles correspondant. On comprend du même coup la place centrale qui revient à l’analyse des erreurs des élèves, lesquelles révèlent l’état de leurs représentations, dans la conduite des apprentissages.
Les obstacles à l’appropriation des connaissances seront surmontés d’autant plus efficacement que ces dernières seront abordées comme l’issue d’un problème à résoudre, les élèves étant confrontés au problème avant de l’être à leur solution. Mais le constructivisme pédagogique et la conduite des apprentissages par la pratique des « situations-problèmes » ne peuvent être efficaces en matière de transmission des savoirs que s’ils sont conscients de la différence entre les problèmes qui font sens pour les élèves et ceux qui ont une signification pertinente pour la connaissance. Partir d’un problème qui fait sens pour les élèves pourra les sensibiliser et les mobiliser, mais peut en même temps court-circuiter le problème scientifique : le savoir visé ne sera plus alors atteint comme un résultat de l’activité intelligente des élèves, mais devra être délivré comme un savoir achevé. Le constructivisme pédagogique n’a d’intérêt, au bout du compte, que s’il permet aux élèves de s’approprier la position scientifique du problème…
Éléments de débat
Pour les partisans d’une véritable démocratisation de l’accès aux savoirs élaborés, les réflexions de J-P Astolfi s’avèrent au bout du compte tout à fait précieuses. Elles croisent les travaux du GRDS sur nombre de points essentiels : le caractère central, dans les missions de l’école, du processus de transmission-appropriation des savoirs ; la critique de tout utilitarisme des apprentissages, qui ne peuvent trouver leur ressort dans quelque « motivation » préétablie, mais dans « la saveur des savoirs » ; l’exigence du maintien d’une ambition intellectuelle forte avec les élèves d’origine populaire ; la critique corrélative de la « dérive » des pédagogies qui voudraient épargner à ces derniers les « chocs culturels » qu’elles appréhendent ; l’exigence d’une forte maîtrise de leur discipline et de sa didactique par les enseignants, et ce que cela implique au plan de leur formation.
Pour prolonger ces réflexions, dans une sorte de dialogue qui malheureusement ne pourra plus avoir lieu, j’avancerai quelques interrogations.
L’échec scolaire et la difficulté des apprentissages
La première concerne la localisation de la difficulté d’apprentissage. D’un côté, Astolfi s’en prend de façon récurrente à la tentation de l’imputer à la personne de l’élève : par sa critique de la notion d’élève en difficulté qui manque de bases ou de ressources intellectuelles suffisantes, par son rejet du fatalisme du handicap socioculturel, par son refus de toute forme de psychologisation de l’erreur ; comme par son refus de suspendre la possibilité d’un apprentissage à l’existence d’une « motivation » préalable, qui sous ce biais-là encore renvoie l’échec de l’apprentissage à la façon dont il a été conduit.
Cette posture prend de front la culture historique de l’institution scolaire, qui associe spontanément la difficulté d’apprentissage à quelque insuffisance de l’élève. Dans la logique de cette posture, on peut s’attendre à ce qu’Astolfi s’intéresse de près aux façons de conduire les apprentissages qui mettent les élèves en difficulté. Et c’est bien ce qu’il fait, à la fois sous une forme critique, en évoquant les « dérives » du constructivisme et des pédagogies différenciées ; et sous une forme normative, en explicitant les principes d’une action pédagogique qui rende les élèves « sensibles à la saveur des savoirs » et leur permette d’en surmonter les obstacles. Tout se passe cependant comme si, à ses yeux, les difficultés des élèves tenaient moins à ces « dérives » qu’à l’objective difficulté d’accès aux savoirs.
« Apprendre ne va jamais de soi. C’est un processus exigeant et souvent contourné, parce qu’il nécessite une rupture avec les représentations, une inhibition des certitudes et le développement de médiations » (p. 40). Ce rappel bachelardien que l’accès à la connaissance ne va pas sans confrontation à d’inéluctables obstacles est certainement bienvenu face à l’illusion si fréquente des pédagogies douces qui croient possible d’éliminer les aspérités des apprentissages. Mais en même temps l’insistance sur les exigences de l’apprendre invite à considérer l’échec de l’apprentissage comme le fait de l’élève qui peut ne pas être prêt à consentir à ces exigences et préférer les contourner. Inévitablement, en ce sens, l’accent mis sur l’ampleur de l’obstacle à franchir pour accéder à la connaissance, le durcissement systématique de la rupture épistémologique à accomplir, ramènent le regard sur l’élève… et le détourne de la part prise dans la difficulté d’apprendre par les dispositifs pédagogiques à l’œuvre.
Deux autres aspects de l’argumentation d’Astolfi viennent renforcer l’impression du lecteur qu’au fond ce n’est pas tellement aux « dérives » du constructivisme mais bien plus aux difficultés objectives de l’apprendre qu’il convient d’imputer l’échec scolaire.
La complexité croissante des savoirs
D’une part Astolfi reprend la thématique de la complexité croissante des savoirs et des exigences scolaires. Non seulement, si l’on préfère, l’accès aux savoirs est complexe par nature, mais cette complexité va croissant avec le développement historique. Là encore la chose est peu contestable. Même si l’opposition : sous la 3ème République on faisait apprendre par cœur, maintenant on fait appel à la réflexion des élèves, est un peu simpliste, il reste que la vie sociale exige de plus en plus de connaissances et de capacités réflexives, et que ces exigences se retrouvent d’une façon ou d’une autre dans les réquisits scolaires. Mais souligner cette évolution historique sans interroger la façon dont sont conduits les apprentissages supposés porteurs d’exigences cognitives nouvelles revient à dédouaner à bon compte les pédagogies à l’œuvre.
Astolfi illustre sa réflexion sur la complexité variable des savoirs par l’exemple de la lecture. Relevant que « les professeurs de collège sont souvent persuadés qu’une bonne proportion des élèves de 6ème ne sait pas lire », il suggère de ne pas se hâter d’incriminer les pédagogies du primaire… et de considérer plutôt que « les textes qui sont donnés à lire dès le début du collège sont d’un type nouveau, rarement rencontrés auparavant par les élèves, qui doivent donc apprendre à les lire » (pp. 141 et 142). Une telle observation ne témoigne pas d’une grande estime pour le jugement professionnel des professeurs de collège. Et cette réduction du lire au comprendre (ils ne savent pas lire ces textes parce qu’ils ne les comprennent pas), qui élimine aussi radicalement le savoir déchiffrer, laisse pour le moins perplexe. Elle est peu convaincante : les élèves qui, évalués à l’entrée en 6ème, maîtrisent la lecture du type de textes qu’on pratique en primaire n’éprouvent pas de problèmes particuliers pour suivre la scolarité proposée au collège (par contre, quand ce n’est pas le cas, ils se retrouvent 20% « en grande difficulté de compréhension de l’écrit » à 15 ans). Mais le fait d’invoquer la complexité des textes à lire au collège détourne le regard de la façon dont on conduit l’apprentissage de la lecture en primaire, et permet ainsi de faire l’économie de toute inquiétude quant à l’efficacité des approches globales, qu’Astolfi, comme nombre de membres de sa communauté universitaire pas plus spécialistes que lui de la question, défend par ailleurs (pp. 74-75). [4]
L’oralité et la littératie
D’autre part Astolfi reprend encore une autre thématique qui vient couramment justifier la fréquence aujourd’hui de l’échec scolaire : celle de l’« hétérogénéité croissante des publics scolaires » (p. 15). Qu’on perçoive cette hétérogénéité comme liée à la diversification du recrutement géographique et linguistique des élèves, ou comme la conséquence de l’allongement des études, elle renvoie de toute façon à la difficulté pour l’école de compenser les inégalités culturelles, en assurant un accueil efficace des élèves les plus éloignés de la culture écrite et des attentes scolaires. Et là aussi, loin d’interroger les raisons de cette difficulté, Astolfi tend à la naturaliser en durcissant l’écart entre le monde de l’oralité et celui de la culture écrite. « Le fonctionnement premier des possibilités mentales de l’homme n’est pas orienté vers une connaissance spéculative, gratuite et réflexive », laquelle « sera l’apanage de l’univers scolaire », note-t-il ainsi (p. 180). Dès lors l’entrée dans la culture scolaire implique une profonde rupture épistémologique, « une véritable conversion de l’esprit », qui a tout de la « violence » d’un « saut dans le vide », puisqu’il s’agit de « renoncer à ses certitudes » et de passer d’un « savoir pour agir » à un « savoir pour comprendre conceptuellement » (p. 181). L’univers de l’oralité est ainsi donné en « opposition radicale » à celui de la littératie. Opposition entre le concret, le non logique, le non pensé, et le monde de la connaissance réfléchie, entre l’automatisme des apprentissages du langage (« les enfants ne cherchent pas à comprendre le fonctionnement de la langue, ils réussissent seulement à parler ») et la posture distanciée et réfléchie qu’implique celui de la lecture et de l’écriture.
La vision de l’oralité que propose Astolfi est conforme à la tradition pédagogique qui court de Rousseau à Piaget. C’est une tradition à la fois ethnocentriste et scriptocentriste, qui va à l’encontre de tout ce que nous apprennent aujourd’hui l’anthropologie, la linguistique, la psycholinguistique. Il est incontestable que la pratique de l’écrit favorise une attitude distanciée et réfléchie à l’égard des objets du monde et du langage lui-même, le développement de l’abstraction et de la pensée rationnelle, la formation des concepts scientifiques. Mais ce constat n’autorise pas à prêter à l’oralité des propriétés inverses de celles qui spécifient la culture écrite délivrée par l’école. De fait les cultures orales, comme les enfants d’avant l’entrée dans la culture écrite, n’ignorent ni la logique, ni la réflexion et la spéculation. Contrairement à ce qu’affirme Astolfi, l’entrée dans le langage est un processus d’appropriation active et intelligente qui n’est pas moins difficile et complexe que l’apprentissage du lire-écrire. Elle permet la formation d’une aptitude à la pensée rationnelle, abstraite, réflexive, la constitution donc de ressources cognitives dont la méconnaissance ne permettrait pas de comprendre comment peut bien s’opérer l’entrée dans la culture écrite. [5]
L’on ne saurait reprocher à Astolfi de souligner, après les travaux de Goody au plan historique et de Vygotski au plan du développement individuel, l’importance de la « conversion de l’esprit » qu’implique l’entrée dans la culture écrite. Mais cette conversion n’est pas une « opposition radicale » : tous les enfants disposent, même ceux qui viennent de milieux socioculturels peu pénétrés par la littératie, de l’outillage mental nécessaire pour accomplir cette conversion.
Il est vrai qu’une vision plus dialectique des rapports entre l’oralité et la littératie, en termes de développement/transformation plutôt que de rupture et d’opposition, impliquerait que les difficultés de l’entrée dans la culture écrite soient tout aussi bien référées à l’insuffisante efficacité des pédagogies actuelles qu’à la nature du saut à accomplir…
Conclusion
L’ambition d’introduire les jeunes générations dans la culture écrite et de leur permettre de gravir les sentiers escarpés de la connaissance, pour reprendre une formule de Marx, est une affaire sérieuse, dont Astolfi a bien raison de souligner la complexité et les exigences. Si l’institution scolaire a du mal aujourd’hui à y satisfaire s’agissant du plus grand nombre, ce n’est pas seulement en raison de la difficulté objective des apprentissages savants, de l’élévation historique des exigences scolaires, de l’hétérogénéité croissante des publics accueillis. L’expliquera-t-on mieux en invoquant les « dérives » qui obèreraient la mise en œuvre des pédagogies constructivistes et différencialistes, au principe de la rénovation des années 1970/1980 ?
C’est là une interrogation récurrente. Face aux limites d’efficacité de notre système éducatif, leurs adversaires mettent en cause les « pédagogies nouvelles », leurs partisans invoquent les dérives de leur mise en œuvre. L’affrontement dure depuis des années, et il n’a jusqu’à présent pas beaucoup fait bouger les lignes. Il serait certainement utile, pour le rendre plus productif, de chercher à préciser les termes du débat. On pourrait notamment se demander qui « dérive », par rapport à quoi, et pourquoi. Je me contenterai ici, pour terminer, de quelques brèves remarques.
On observera d’abord que le fonctionnement actuel du système éducatif est conforme par bien des aspects aux intentions de ses promoteurs et qu’il n’y a pas lieu à leur égard de suspecter de dérive très significative. Ainsi le souci d’éviter les « chocs culturels » trop forts aux élèves des classes populaires, dont Astolfi déplore les effets, était-il au cœur de la rénovation de l’enseignement élémentaire dans les années 1970. [6] Les pédagogies douces et concrètes, mises en œuvre à cette fin en matière d’entrée dans le lire-écrire et les mathématiques, ont été promues dans les IUFM, encouragées par l’inspection, validées dans les manuels et les fichiers d’élèves, et sont pratiquées par une énorme majorité d’enseignants (et Astolfi lui-même y souscrit concernant les approches globales de la lecture).
Comment dans ces conditions l’idée d’une « pédagogie différenciée » pouvait-elle être entendue autrement que comme une invitation à en rabattre quant à l’ambition intellectuelle de l’enseignement pratiqué avec les publics populaires ? [7] Quand, à l’encontre, Astolfi demande que les savoirs soient « élémentés » plutôt qu’abrégés, il faudrait pour être entendu accompagner cette demande d’une discussion critique de tout ce qui s’est dit et fait en ce domaine depuis les années 1970.
De la même façon, quand tout le discours des promoteurs de la rénovation pédagogique a été centré sur la nécessité de motiver les élèves en partant de leur vécu, peut-on parler d’une « dérive » quand les enseignants, qui ne font jamais d’ailleurs à cet égard que suivre la plupart des manuels, proposent à leurs élèves des « situations-problèmes » qui font peut-être sens par rapport à leur expérience (et encore ce serait à vérifier), mais n’ont guère de signification scientifique ? Et peut-on parler d’une « dérive » quand la conduite des apprentissages se préoccupe davantage de créer au préalable la motivation pour apprendre que de la soutenir par leur déroulement réussi ? Si, en fin de compte, le constructivisme aujourd’hui pratiqué dans notre système éducatif n’a trop souvent « de constructiviste que le nom », le ver n’était-il pas dans le fruit dès le départ ?
Les faits sont têtus, les pratiques persistent, les dispositifs pédagogiques restent peu conformes aux recommandations astolfiennes. Le discours normatif de la didactique éclaire utilement notre réflexion. C’est sur le terrain, par l’analyse des pratiques, la collecte des expériences réussies, l’expérimentation menée par les enseignants, que l’on pourra vérifier sa pertinence.
[1] La Saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d’apprendre, ESF, Issy-les-Moulineaux, 2008, rééd. 2010.
[2] On pourra se reporter, pour les hommages posthumes, au dossier rassemblé par les Cahiers pédagogiques.
[3] Ainsi, évoquant dans La Saveur des savoirs l’inachèvement de l’organisation cérébrale de l’homme à la naissance et l’exigence conjointe d’appropriation d’un patrimoine de l’espèce qui apparaît dès lors extérieur à chaque individu, Astolfi se réfère à Bernard Charlot plutôt qu’à Lucien Sève. Ou encore, traitant des rapports entre l’oralité et la culture écrite, il emprunte à la linguistique scolaire plutôt qu’à Jack Goody. Décrivant les pratiques purement orales du langage il ne songe pas à s’appuyer sur les apports anthropologiques en la matière, pas davantage qu’il ne recourt à ceux de la linguistique générale concernant l’entrée des enfants dans le langage.
[4] Pour avoir une idée de la réalité de la langue écrite de bien des collégiens de ZEP (et d’ailleurs !), le lecteur qui n’y enseigne pas pourra consulter la contribution de Marc-Olivier Sephiha sur ce site, Collège : traiter les dysorthographies ?...
[5] Je renvoie, pour le développement de ces observations, à mon ouvrage De l’oralité. Essai sur l’égalité des intelligences, La Dispute, Paris, 2009.
[6] Cf. Jean-Pierre Terrail, Enseignement élémentaire : les leçons de l’expérience, www.democratisation-scolaire.fr
[7] Il suffit d’ailleurs de relire Louis Legrand pour constater qu’il ouvrait lui-même grande la porte à cette interprétation. On pourra se reporter à son ouvrage Les différenciations de la pédagogie, PUF, Paris, 1995 ("La connaissance sociologique des milieux d’origine pourra conduire à moduler l’enseignement en fonction des attentes supposées"), et au commentaire que j’en propose in De l’inégalité scolaire, La Dispute, Paris, 2002, chapitre 12.


Messages
1. L’école et les savoirs. A propos d’un ouvrage d’Astolfi, 29 septembre 2012, 11:06, par Ignace RAK
Bonjour
Il faut apprécier cet ouvrage de J.P. Astolfi comme fondamental, et, selon moi, l’apprécier au travers de chaque discipline existante pour savoir comment son analyse et ses perspectives peuvent être prises en compte pour jeter un regard nouveau sur ses propres pratiques d’enseignant.
Je ne suis pas chercheur, mais seulement formateur et un militant.
Pour l’association internet PAGESTEC des professeurs de technologie et ses deux listes de discussion privées, j’ai tenté de voir chapitre par chapitre, comment dans cette discipline "d’éducation technologique" incorrectement nommée "technologie", il est possible d’aider les professeurs à intégrer ces concepts didactiques et pédagogiques combien essentiels pour préparer, puis conduire le déroulement d’une séquence ou séance d’enseignement. Dans un premier temps, il me semble que seule une transcription et des essais disciplinaires me paraissent pouvoir donner un sens concret aux écrits de J.P. Astolfi.
Pour celles et ceux que cela intéresse, vous pouvez prendre connaissance des cinq premiers documents rédigés sur mon site personnel technoHADF sous le titre "Les savoirs selon J.P. Astolfi ? Et en technologie ?". Les autres documents seront publiés à raison d’un par mois jusqu’en janvier 2013. Et vous pouvez suivre ces publications via le flux RSS.
Bien cordialement à toutes et à tous.
Ignace RAK IA IPR STI honoraire de l’Académie de Paris, docteur en sciences de l’éducation en sciences et technologie de l’ENS de Cachan. 29-09-2012.
Voir en ligne : Les savoirs selon J.P. Astolfi. Et en technologie ?