Accueil > Culture commune/séminaire > Histoire des disciplines > Culture commune et enseignement des mathématiques à travers deux siècles (...)
 Culture commune et enseignement des mathématiques à travers deux siècles d’histoire
Culture commune et enseignement des mathématiques à travers deux siècles d’histoire
lundi 19 mai 2014, par
Au regard de l’histoire de la société française, une telle préoccupation - celle d’une culture commune - est relativement récente [1]. L’histoire scolaire de la France, depuis la Révolution et le monopole de l’État sur la délivrance des diplômes et des grades, a été longtemps celle d’une école duale structurée en deux ordres distincts. Jusqu’aux années 1950 cette école par ordres scolarisait la jeunesse du pays dans des systèmes distincts avec des publics, des finalités, des contenus, des cultures, des maîtres distincts : un ordre secondaire, des petites classes élémentaires jusqu’au baccalauréat, destiné à une élite sociale et intellectuelle étroite (3% des garçons jusqu’à la première guerre mondiale, 10% à la veille de la seconde guerre mondiale), et un ordre primaire destiné à la scolarisation, y compris prolongée, des enfants des classes moyennes et populaires. C’est à partir des réformes scolaires de la fin des années 1950 et des années 1960, avec l’avènement d’une école par degrés et la démocratisation de l’accès, pour tous, au secondaire, que la question d’un enseignement commun de mathématiques à toute une classe d’âge, d’une culture mathématique commune, va se poser dans la conception des programmes.
Nous regarderons ici ce qu’il en a été, du début du XIXe siècle aux années 2000, pour les enfants scolarisés au delà de l’instruction élémentaire, soit au-delà de 12 ans.
À chaque ordre sa culture, à chaque ordre ses mathématiques (des années 1830 aux années 1950)
« Pour ceux qui poursuivent la théorie il peut être permis d’affecter de l’indifférence pour le côté pratique ; pour vos élèves […] cette indifférence n’aurait pas d’excuse. » Voilà, ainsi posée par l’Inspecteur du Calvados en 1835 devant les instituteurs de son département, une des différences caractéristiques entre les enseignements de géométrie dans l’ordre secondaire et dans l’ordre primaire. Enseignement et culture théoriques versus enseignement et culture pratiques, tels vont être les enjeux identitaires des deux ordres, qui ont perduré plus d’un siècle.
L’ordre secondaire : les contradictions d’un enseignement visant à la culture de l’esprit
En 1802, les lycées - dont la finalité est la formation des élites administratives et intellectuelles de la nation - sont créés en plaçant, à la base de l’enseignement qui y est donné, les mathématiques au même rang que le latin. Il s’agit là d’une nouvelle donne due à la Révolution française où les mathématiques sont devenues partie prenante d’une éducation intellectuelle alliant théorie et pratique. Sous l’Ancien Régime, au contraire, considérées avant tout comme une discipline de spécialisation professionnelle pour l’entrée dans les métiers des armes savantes, les mathématiques sont disqualifiées pour contribuer à l’éducation classique des élites, à la formation de l’esprit réservée avant tout aux humanités classiques. Ce rôle « culturel » de l’enseignement des mathématiques ne dure pas. L’organisation des études, dès l’Empire, donne au latin et aux humanités une place prépondérante, repoussant l’étude des mathématiques (et des sciences) aux toutes dernières classes, dites « classes d’humanités », c’est-à-dire pour des élèves qui ont déjà reçu le bénéfice d’une formation générale classique dans les classes précédentes. Elles ont alors un statut d’enseignement dit « accessoire », mais portent la marque de cet ordre secondaire qui dispense un enseignement théorique, abstrait, dit « désintéressé » : elles sont coupées de leurs applications utiles et privilégient l’abstraction et les raisonnements rigoureux.
L’institution scolaire connaît dans les années 1830 de profondes modifications avec la création d’un ordre primaire (loi Guizot, 1833) constitué en deux degrés, l’enseignement primaire élémentaire et l’enseignement primaire supérieur, dont la vocation est la formation du peuple mais aussi des nouvelles couches sociales qui apparaissent avec la première révolution industrielle et le développement du commerce, des banques, des administrations, des transports. Le ministre considère que l’enseignement élémentaire réduit au « lire, écrire, compter » ne leur suffit pas et que l’enseignement secondaire, théorique, abstrait et long de sept années d’études, ne peut leur convenir. Face à cet ordre primaire, utilitaire et pratique, l’ordre secondaire affirme et défend donc, en mathématiques comme dans les autres disciplines, une identité d’enseignement de « culture » et de formation de l’esprit de l’Élite. Et cela tout au long du XIXe siècle, même si une partie des élites industrielles, techniques et économiques ne se retrouvent pas dans ces finalités de l’ordre secondaire et de la culture qu’il promeut. Mais les tentatives faites pour ouvrir l’enseignement secondaire à d’autres finalités, à d’autres méthodes qui privilégieraient tout à la fois les sciences, dont les mathématiques, l’utilité et la simplicité, le recours au concret plutôt qu’à des raisonnements abstraits (cf. la réforme de la bifurcation (1852), la création de l’enseignement secondaire spécial (1866)) se soldent, à plus ou moins long terme, par un retour « à l’admirable enchaînement des propositions d’Euclide » (Victor Duruy, 1863) et à la culture mathématique théorique et abstraite.
Le XXe siècle s’ouvre avec une réforme des lycées (réforme de 1902-1905) qui, face aux besoins de formation liés à la seconde révolution industrielle et au développement de la France coloniale, cherche à faire bouger la culture secondaire. Il s’agit de rendre cette culture plus complète alliant humanités classiques et humanités modernes dont les humanités scientifiques. Pour les mathématiques, l’enjeu de la réforme, tel que l’énonce le mathématicien Émile Borel, est d’« introduire plus de vie et de sens du réel dans notre enseignement mathématique », afin que les élèves « se rendent compte par eux-mêmes que les mathématiques ne sont pas une pure abstraction ». Il faut à présent enseigner des mathématiques, de la géométrie – et de façon conséquente – dès le début du premier cycle : on recommande alors le recours au concret, à l’expérience, à l’induction, première étape nécessaire avant le passage au raisonnement déductif. Il faut, dans le second cycle, introduire de nouvelles notions liées à l’étude des fonctions et de leurs variations : l’enseignement sera lié à celui de la physique et à ses besoins. C’est à ce titre que les mathématiques participent alors d’une formation humaniste et acquièrent, dès les premières classes du secondaire, une place reconnue dans la formation générale de l’esprit.
L’esprit de la réforme de 1902 fait, d’une certaine façon, violence au modèle libéral de la culture secondaire. Il est rapidement mis en cause dans l’Entre-deux–guerres, dès la réforme Bérard de 1923, qui entend revenir à l’esprit de l’enseignement classique. Celle-ci prend le contre-pied de celle de 1902 dont elle écarte la dimension pratique et concrète, c’est-à-dire son aspect « moderne », au profit de considérations plus théoriques afin de favoriser, avec les mathématiques, l’éveil du sens critique et l’accès aux idées générales. C’est cette conception d’une culture mathématique secondaire qui perdure jusqu’à la fin des années 1950.
L’ordre primaire et la dimension pratique : d’une finalité à une ambition culturelle
L’enseignement des mathématiques dans l’instruction primaire supérieure - ou plutôt l’enseignement de la géométrie, car le terme « mathématiques » n’est pas employé - doit être lié, selon les termes de la loi de 1833, à ses applications usuelles que sont le dessin linéaire et l’arpentage. Euclide et ses « admirables propositions » ne font pas partie de l’horizon de l’ordre primaire. La géométrie qu’introduit la loi Guizot symbolise tous les enjeux de la dualité scolaire, et agit comme un indicateur des limites dans lesquelles doit être enfermé l’enseignement du peuple, y compris de ses élites. Si l’enseignement des humanités, inconcevable dans l’ordre primaire, incarne au premier chef la distinction sociale d’une formation et d’une culture secondaires, il n’est pas le seul. La nature de l’enseignement de la géométrie – présent donc dans les deux ordres — est un marqueur tout aussi fort. Dans l’ordre primaire, la géométrie ne peut être que pratique, enseignée à travers ses applications et détachée de tout raisonnement abstrait a priori réservé à l’enseignement secondaire.
Avec la Troisième République et la loi Ferry de 1882, le mot « mathématiques » est employé pour la première fois dans la législation de l’enseignement primaire. Même réduite aux « éléments des sciences mathématiques », cette apparition dans la définition des matières de l’école primaire (élémentaire ou supérieure) témoigne d’une nouvelle ambition quant à la formation intellectuelle dispensée dans l’ordre primaire, l’école de Jules Ferry s’inscrivant toujours, précisons-le, dans le contexte réaffirmé de la dualité scolaire des deux ordres. Marque de cette nouvelle ambition culturelle, la dimension pratique de l’enseignement de l’arithmétique, de la géométrie, de l’algèbre dans le primaire supérieur, a une nouvelle signification. Le recours à la pratique ne traduit plus seulement le refus, pour un public populaire, de toute théorie, jugée socialement dangereuse : en faisant appel à l’activité des élèves, à leur expérience sensible, à l’observation, l’enseignement mathématique est porteur des ambitions éducatives de la rénovation pédagogique engagée par les républicains au pouvoir, que symbolise la leçon de choses. L’enseignement mathématique se développe ainsi dans le primaire supérieur autour d’une culture pratique, exigeante et efficace, qui fait que les élèves du primaire supérieur ont, contrairement à leurs camarades de 12 à 15 ans scolarisés dans le secondaire où la discipline mathématique est marginalisée, une réelle pratique des mathématiques – arithmétique, algèbre, géométrie - étudiées du point de vue de leurs applications, dans le cours normal de leurs études.
Cette culture primaire, si elle est celle des programmes et des méthodes des élèves des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires (que créent les lois Ferry), est également celle des enseignants. Les enseignants de mathématiques du primaire, y compris du primaire supérieur, sont d’anciens élèves de l’ordre primaire, normaliens des écoles normales primaires et, pour les plus qualifiés, des écoles normales primaires supérieures où ils ont été formés dans l’ordre des sciences. Ils ont ainsi une formation ancrée dans la réalité, le concret, mais également ouverte aux autres sciences et à leurs applications. Toutes choses radicalement différentes de la formation universitaire des professeurs de mathématiques du secondaire, qu’ils soient agrégés ou licenciés.
Les réformes de la fin des années 1930, avec le Front populaire, qui voit l’harmonisation des programmes du primaire supérieur et du premier cycle du secondaire, ne changent pas vraiment la donne. Les réformes de Vichy, qui supprime les écoles normales primaires, vont par contre avoir des effets notables au niveau de la culture des nouveaux maîtres : ceux-ci, dorénavant, vont poursuivre leurs études dans des collèges secondaires et passer le baccalauréat.
Et les filles ?
C’est la scolarisation des garçons que visaient les premières lois du XIXe siècle mentionnées plus haut. Or poser la question de la culture commune ne peut se faire en faisant l’impasse sur une moitié de la population scolaire. Les premières à entrer dans le champ de l’institution scolaire sont les filles des couches populaires et des classes moyennes, et cela dès 1850 où les programmes des filles, pour l’ordre primaire, sont assez semblables à ceux des garçons. En revanche, les filles ne sont scolarisées dans l’enseignement secondaire public féminin qu’à partir de 1880. Les lycées de filles portent dès leur création la marque d’une culture « genrée » : pas de baccalauréat, car pas d’entrée à l’université pour les filles, pas de latin, pas d’humanités classiques, et des programmes de mathématiques avec une orientation pratique adaptée « aux qualités et destins des jeunes filles », qui donnent moins de place à la rigueur et à l’abstraction que ceux des lycées de garçons d’avant 1902. Les filles n’ont, on le sait, pas la tête à l’abstraction… Ce n’est qu’au milieu des années 1920 que l’enseignement des filles sera couronné d’un baccalauréat et que les programmes seront alignés sur leurs homologues masculins.

Des mathématiques pour tous ou les questions impensées (les années 1960 -1970)
Des réformes structurelles et disciplinaires
Au début des années 1960, des réformes structurelles - Berthoin (1959) et Fouchet-Capelle (1963) – font passer de l’école par ordres à une école par degrés. Tous les enfants, après un même primaire élémentaire (premier degré), doivent avoir une poursuite de scolarité dans le second degré ; cette scolarité prolongée est différenciée – avec des programmes et des établissements dédiés – courte ou longue, avec des finalités de poursuite d’études ou d’entrée dans la vie active selon les voies et filières dans lesquelles sont les élèves. Dans le même temps, cette démocratisation de l’accès à l’enseignement secondaire, qui accroît le poids des filières modernes sans latin, et l’adaptation du modèle éducatif aux besoins, véritables ou supposés, engendrés par la modernisation industrielle – il s’agit de former les cadres scientifiques et techniques dont le pays a besoin –, renforce la place des sciences, et plus particulièrement celle des mathématiques, dans l’équilibre des disciplines, au détriment du latin. Le poids croissant de celles-ci dans les études supérieures (ainsi en médecine ou en sciences humaines) renverse la hiérarchie des sections, si bien que, à partir de 1965, la section C et, dans une moindre mesure, la section S qui lui succède, sont devenues celles de la formation des élites, et les mathématiques une véritable discipline de sélection.
Autre facteur de bouleversement dans l’enseignement des mathématiques de ces décennies – et dans la/les culture/s qu’il délivre - la réforme dite des « mathématiques modernes ». Issue d’une réflexion entamée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tant au niveau national qu’international par des mathématiciens, des pédagogues, des psychologues, cette réforme est conduite à partir de 1966 par une commission ministérielle, la Commission Lichnerowicz , unanimement soutenue en France dans un premier temps, y compris par les milieux politiques et industriels. Son projet de réforme se fonde sur une critique de l’enseignement mathématique traditionnel (symbolisé par la géométrie classique), jugé trop éloigné des mathématiques vivantes, c’est-à-dire telles qu’elles se font et s’enseignent dans les facultés depuis le milieu des années 1950 avec l’algèbre des ensembles et la primauté des structures et du formalisme, le calcul des probabilités, la statistique. Convaincus que les mathématiques doivent jouer un rôle moteur dans le développement des sciences et des techniques – y compris les sciences humaines et sociales – ainsi que dans la vie quotidienne des citoyens, et, au-delà, dans la modernisation de la société, ses promoteurs y voient un nouveau langage permettant à tous les citoyens d’en comprendre le fonctionnement.
Le modèle de l’élite décliné pour tous
Il est important de souligner ici deux enjeux identitaires majeurs de cette réforme qui allaient s’avérer être sources de difficultés majeures. Le premier est que, compte tenu des réformes structurelles, la réforme devait s’adresser à tous les élèves, quel que soit leur futur à l’école et dans la société. Le deuxième est qu’elle devait embrasser toute la scolarité, depuis l’école maternelle jusqu’à l’université. Cette réforme, de façon inédite dans l’histoire, a donc cherché à penser un unique curriculum mathématique pour des enfants jusqu’alors scolarisés dans les univers différents des ordres primaire et secondaire, seule une petite minorité d’entre eux (et de leurs professeurs) ayant été jusqu’alors concernés par les enjeux des « mathématiques vivantes », celles du monde de la recherche et de l’enseignement supérieur, pour reprendre l’expression des réformateurs. Le mot d’ordre de l’APMEP, l’Association des professeurs de mathématiques, partie prenante de ce mouvement réformateur, illustre cette intention : « Des mathématiques pour tous, de la maternelle à la Sorbonne ».
Une citation montre la difficulté objective et, tout à la fois, la bonne volonté, l’incapacité et l’impréparation de la Commission Lichnerowicz pour prendre en charge le problème de la « démocratisation », pour se préoccuper d’autre chose que des besoins induits par les études longues et les carrières universitaires. Évoquant, dans une réunion de la Commission, la question de la réforme pour les filières courtes préparant à la vie active, un des membres résume la question en disant : « Faut-il enseigner des mathématiques désuètes aux enfants moins intelligents ? ». Les membres de la Commission, qui est presque exclusivement constituée de personnalités issues de l’ex-ordre secondaire, n‘ont aucune expérience de la « culture primaire ». Les conceptions sur la démocratisation de l’enseignement, héritées de l’Entre-deux-guerres, qui se sont alors imposées comme évidentes, considéraient le modèle pour l’élite, le modèle du secondaire, comme le meilleur possible devant, comme tel, être appliqué à tous. Il en fut ainsi pour les mathématiques, où les traditions mathématiques et pédagogiques de l’ordre primaire furent laissées de côté au profit de celles du secondaire. Le débat sur une culture mathématique commune n‘a pas lieu ; les effets pervers de la réforme des mathématiques modernes et de ses programmes dans les années 1970 en terme de sélection sociale féroce, ne sont en aucun cas anticipés par les réformateurs.
Entrée en application à partir de la rentrée 1969, la réforme s’accompagne de la mise en place progressive d’Instituts de recherche sur l’enseignement des mathématiques (IREM) chargés notamment du recyclage des maîtres. Les nouveaux programmes, qui intègrent les concepts, le vocabulaire et le symbolisme de l’algèbre moderne, privilégient l’initiation aux structures mathématiques et leur construction axiomatique. Ils lient étroitement l’enseignement de la discipline au développement des structures mentales de l’enfant mis en évidence par la psychologie génétique de Jean Piaget qui a considérablement influencé les promoteurs des mathématiques modernes en France. La modernisation des contenus se double d’ailleurs d’une rénovation des méthodes pédagogiques, misant sur l’activité de l’élève en vue d’articuler expérience concrète et nécessaire abstraction.
Contradictions et dissensions
Au début des années 1970, à l’occasion des travaux sur les programmes des classes de quatrième et troisième, des dissensions éclatèrent au sein de la Commission et l’unanimité du début se brisa. Ces programmes, pour des classes de fin de scolarité obligatoire et dans lesquelles les enseignants étaient en grande majorité peu formés, posaient en effet des problèmes tout à la fois d’ordre mathématique et sociétaux particulièrement aigus. Des mathématiciens et des physiciens dans et hors de la commission commencèrent à critiquer la prédominance des approches formelles et abstraites dans les programmes de mathématiques. Formalisme et abstraction n’étaient pas profitables pour la grande majorité des élèves et des professeurs, mal préparés pour cela. Mais ils ne l’étaient pas non plus, disaient-ils, pour la formation des futurs physiciens ni pour les futurs ingénieurs. Des critiques tout aussi sévères sont venues ensuite des associations professionnelles telles que l’APMEP ou même les IREM, des milieux universitaires, de l’Académie des Sciences, des milieux économiques et industriels.
En 1975 la réforme Haby, dernière étape des réformes structurelles engagées par la Ve République, substitue aux voies diversifiées de poursuite de scolarité dans le premier cycle du secondaire le « collège unique ». Cette nouvelle structure est censée scolariser dans un cursus unique les élèves du premier cycle du second degré. Le ministre Haby, s’exprimant sur les contenus mathématiques pour un tel collège unique, critique de fait les positions des réformateurs des mathématiques modernes quant à leurs ambitions pour des mathématiques pour tous. Il distingue deux type de mathématiques, deux types de culture mathématiques : 1/ les mathématiques du « concret », « simples » conduisant à « l’acquisition » des techniques de calcul, utiles à tous les métiers, souvent indispensables : ce sont les mathématiques pour tout le monde ; et 2/ les mathématiques « modernes », « abstraites », celles qui forment l’esprit, celles qui permettent de « dominer » les techniques de calcul ; elles seront réservées à ceux qui poursuivront des études de haut niveau parce qu’ils en ont les capacités. Une position qui est donc radicalement différente de celle portée par les réformateurs des années 1960 quant à ce que devrait être une culture commune en mathématiques ; et qui, renvoyant aux temps de la dualité scolaire, s’appuie sur une « fausse dichotomie entre le concret et l’abstrait », dénoncée par l’APMEP. Néanmoins les programmes de 1977 pour le collège ne sont pas en rupture avec les ambitions des mathématiques modernes des programmes précédents.
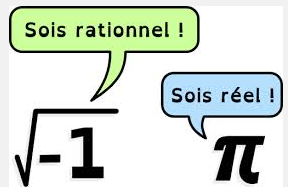
Le temps du collège unique et de la seconde indifférenciée (1980-2000)
Les programmes des années 1980 : éviter le formalisme et donner du sens ; de nouvelles composantes de la culture mathématique scolaire
Les programmes de 1981 (pour le second cycle), inspirés par les IREM, annoncent une nouvelle donne tant pour le collège que pour le lycée : « Les actuels programmes de mathématiques pour le premier cycle ont entrepris de lutter contre un formalisme qui, maltraitant l’acquis intuitif des élèves, isolerait la démarche pédagogique de l’expérience et de l’action (...). Il importe que toute introduction d’une notion ou d’un théorème soit précédée de l’étude d’une situation assez riche pour en attester l’intérêt et qu’elle soit suivie immédiatement d’applications substantielles (…) ». De plus, l’année scolaire 1981-1982 voit la mise en place de la classe de seconde indifférenciée (ou seconde pour tous) en lycée général et technologique. Il s’agit là d’un changement structurel dont les conséquences pour l’enseignement de la discipline (et la question de la culture commune) sont importantes : l’orientation des élèves se fait désormais à la fin de la seconde et le programme de cette classe doit donc s’appliquer à tous les élèves.
De nouvelles branches et nouveaux outils mathématiques conquièrent une place réelle dans les programmes : la statistique, qui doit être étudiée en lien avec des systèmes physiques, biologiques, économiques ; les calculatrices, dont l’usage modifie les pratiques de calcul et qui permettent également de construire des algorithmes simples. L’enseignement de la géométrie est réorienté vers une « méthode franchement expérimentale (…) au service de l’intuition et de l’imagination (…) », mais il est réservé, dans le second cycle, à la classe de Seconde et aux sections scientifiques. Pour les premières et terminales A1 (lettres classiques), il est spécifié : « (...) on ne manquera pas, chaque fois que l’occasion se présentera, de replacer les questions dans leur contexte historique ; en premières et terminales A2-A3 (lettres et langues vivantes), le programme a pour objectif : « une formation à la réflexion et à une démarche scientifique qui sera (…) un terrain d’investissement d’une culture philosophique ». Et pour ces filières, il est précisé : « (…) on ne confondra pas les ambitions théoriques modestes avec une activité mathématique pauvre, génératrice d’ennui et de réactions de rejet ». En option, il est proposé, déjà, des activités algorithmiques. Il s’agit de lutter contre l’image des mathématiques qui s’est répandue dans le public (élèves, parents, médias), tout en recadrant les enseignants, investis pendant au moins dix ans dans un enseignement abstrait, théorique, très construit à l’image de l’enseignement supérieur.
Ces programmes officiels mis en place à partir de la rentrée 1981 donnent la couleur de ceux qui viendront durant les trente années suivantes. On peut y voir quelques constantes dans la conception de l’enseignement mathématique, et de la culture mathématique, qu’ils cherchent à promouvoir :
![]() éviter un formalisme et une abstraction a priori, afin de ne pas perdre les élèves (un but clairement annoncé et répété au fil des réformes est d’ouvrir davantage le recrutement dans les sections scientifiques) ;
éviter un formalisme et une abstraction a priori, afin de ne pas perdre les élèves (un but clairement annoncé et répété au fil des réformes est d’ouvrir davantage le recrutement dans les sections scientifiques) ;
![]() introduire les notions à partir de problèmes « concrets » afin de donner un sens et une légitimité à ces notions ;
introduire les notions à partir de problèmes « concrets » afin de donner un sens et une légitimité à ces notions ;
![]() montrer comment les mathématiques interviennent dans les autres disciplines ;
montrer comment les mathématiques interviennent dans les autres disciplines ;
![]() développer l’utilisation de la calculatrice et des logiciels (géométrie dynamique, tableur, traceur de courbe) ;
développer l’utilisation de la calculatrice et des logiciels (géométrie dynamique, tableur, traceur de courbe) ;
![]() fournir quelques repères en histoire des mathématiques : « (…) il convient de mettre en valeur le contenu culturel des mathématiques ; en particulier, l’introduction d’une perspective historique peut permettre aux élèves de mieux saisir le sens et la portée des notions et problèmes étudiés (...) ;
fournir quelques repères en histoire des mathématiques : « (…) il convient de mettre en valeur le contenu culturel des mathématiques ; en particulier, l’introduction d’une perspective historique peut permettre aux élèves de mieux saisir le sens et la portée des notions et problèmes étudiés (...) ;
![]() à travers les instructions et commentaires accompagnant les textes officiels, donner de plus en plus d’indications pédagogiques aux professeurs.
à travers les instructions et commentaires accompagnant les textes officiels, donner de plus en plus d’indications pédagogiques aux professeurs.
Mais ces préconisations se heurtent immédiatement au manque de formation des professeurs dans de nombreux domaines : l’utilisation des calculatrices, la maîtrise de l’informatique et la manipulation des logiciels, l’histoire des sciences et plus récemment l’algorithmique. De plus, l’équipement des lycées et collèges en matériel informatique s’est fait de façon très inégale. Les IREM proposent dans les années 1980 et 1990 des stages, des formations permettant aux professeurs de s’adapter aux programmes (utiliser la calculatrice en classe, gérer une classe hétérogène, enseigner les statistiques, les probabilités, s’initier à l’histoire des mathématiques, etc.). Mais les IREM perdent au fil des années les moyens qui leur permettaient de vivre. La formation continue se fait de plus en plus en dehors du temps de travail et l’offre est moins riche.
Les années 1990 : contre la dictature des mathématiques
Durant ces années la section C devient la voie royale dans le second cycle. C’est elle qui ouvre le plus facilement l’accès aux études supérieures valorisées, elle a la faveur des familles. On voit fleurir les officines vendant des cours particuliers censés mettre les élèves à niveau. Les mathématiques sont la discipline sélective, redoutée, haïe parfois, celle où il faut réussir. Le Conseil national des programmes, dans ses Propositions sur l’évolution du lycée de novembre 1990, fait un constat assez critique sur l’orientation et « (…) des choix actuels trop souvent fondés sur l’échec en mathématiques et en physique ».
À la rentrée 1994, la terminale S devient généraliste, remplaçant les terminales C, D et E. Pour lutter contre « l’hégémonie de la section scientifique », contre « la dictature des mathématiques », les ministères successifs tentent des aménagements : diminution de l’horaire de mathématiques obligatoires puis suppression totale dans la filière L. Ces dernières mesures ne vont pas dans le sens de l’acquisition d’une culture scientifique ; paradoxalement elles appauvrissent la filière littéraire. Cependant elles permettent de réduire le nombre des enseignants. C’est le temps des économies !
Pourquoi enseigner les mathématiques ? La commission de réflexion sur l’enseignement des mathématiques
En 1999, à la demande de l’APMEP, de la SMF et d’autres associations de spécialistes, une commission est constituée par le ministère, chargée de faire un bilan de l’enseignement des mathématiques et d’émettre des propositions pour les années à venir. La commission choisit d’orienter son travail en partant de la question « Pourquoi enseigner les mathématiques ? », qui pilote donc la question des contenus, de la culture mathématique à acquérir. Une première réponse, telle que l’exprime son rapport de 2002, vient des praticiens des autres disciplines : on a besoin de mathématiques en biologie comme en physique ou en économie. Avant tout, on a besoin de l’alliance entre imagination et raisonnement apportée par la démarche mathématique, depuis l’élaboration et la mise en forme des énoncés jusqu’à la démonstration de leurs conséquences. Il faut tenir compte, poursuit le rapport, de ces différents aspects dans le choix des sujets et des programmes, et cela a sous-tendu la réflexion de la commission sur les grands thèmes choisis : géométrie, impact de l’informatique, calcul, probabilités et statistique.
Mais la commission met en avant un autre enjeu : la question est non seulement ce que l’enseignement des mathématiques apporte immédiatement aux élèves pour mieux se situer dans l’ensemble des pratiques et des connaissances, mais aussi, comme pour tout autre enseignement, ce que sont les atouts qu’il donne aux enfants ou jeunes gens d’aujourd’hui pour aborder, au cours de leur vie, les grands problèmes de l’humanité à venir dont nous ne faisons que pressentir la difficulté. La réflexion sur l’enseignement des mathématiques est donc, par nature, une réflexion à long terme. Elle se heurte, dit-elle, à la vision générale des jeunes, des parents, et des enseignants eux-mêmes dans leur pratique, qui est à court terme.
Un mouvement de balancier ? Les difficultés de penser une culture commune
En trente ans, le contenu de l’enseignement a suivi un profond changement le conduisant de l’abstraction et d’un formalisme excessifs à des mathématiques appliquées (applicables ?) qui se veulent en prise avec le « monde réel ». On peut y voir la recherche d’un équilibre assurant à la fois l’acquisition d’une culture scientifique, d’un bagage de connaissances indispensables à toute suite d’études, permettant de passer de problèmes concrets à l’abstraction à travers la mathématisation, dédramatisant l’approche de cette discipline, en enlevant une lourde charge émotionnelle. Cet enseignement est censé donner quelques outils nécessaires au futur citoyen tout en rendant les élève actifs et créatifs.

Or, sur le terrain, les effets de ce changement tardent à se manifester. L’esprit des programmes passe difficilement. Les professeurs ont du mal à mettre en œuvre les préconisations. On peut proposer quelques causes à ces résistances. La première est une tendance naturelle à reproduire ce que l’on connait, c’est-à-dire l’enseignement que l’on a suivi une vingtaine d’année plus tôt. La deuxième est la pauvreté de la formation pédagogique, et surtout de la formation continue, pourtant affirmée comme étant le moteur de toute réforme réussie. Enfin, l’hétérogénéité croissante des classes et la difficulté de pratiquer une pédagogie différenciée sont une réalité de terrain qui semble parfois indépassable, de même que la difficulté de trouver du temps pour une concertation disciplinaire ou interdisciplinaire.
Comment l’enseignant perçoit-il les mathématiques qu’il enseigne ? Y met-il une dimension culturelle ou les voit-il uniquement comme des bases permettant de poursuivre (éventuellement) des études supérieures ? Existent-elles pour elles-mêmes ou pour servir d’autres disciplines ? Les réponses varient selon les individus.
En 1980, André Revuz écrivait un ouvrage au titre provocateur : Est-il impossible d’enseigner les mathématiques ? Il dressait un tableau assez sombre de la situation mais proposait des remèdes utilisant les IREM. Une trentaine d’années plus tard, son analyse reste actuelle. Et pourtant, la Loi d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005, instaurant un socle commun de connaissances et de compétences, semble limiter les connaissances assimilables par toute une classe d’âge. En isolant dans le programme des connaissances et compétences que tout élève en fin de troisième doit posséder et en demandant à l’enseignant d’aller au-delà (dans la limite du programme), on ne l’aide pas à définir pour qui il travaille. En juillet 2010, l’APMEP publiait les résultats d’une enquêtes sur ce socle commun auprès de professeurs de collège. De nombreux collègues ne savent plus où donner de la tête : gérer la classe, assurer le socle pour tous et préparer à la 2nde les élèves qui poursuivront en lycée général, valider le B2i, conserver une évaluation chiffrée indispensable pour l’orientation en fin de troisième… Certains s’engagent dans des évaluations incessantes et chronophages, mais s’interrogent sur la réelle plus-value pour les élèves quand cette évaluation se substitue peu à peu à la construction patiente de savoirs solides et formateurs. Lorsque l’on se plonge dans le document fourni par la Direction générale de l’enseignement scolaire intitulé Socle commun de connaissances et de compétences - Vade-mecum (septembre 2009), on comprend le désarroi des professeurs. Il s’agit d’un catalogue de recettes pour traiter plusieurs tâches simultanément dans une classe hétérogène de collège. Ces recettes marchent, le document l’assure ! On est ici bien loin de la réflexion menée dans les IREM sur la didactique des mathématiques...
[1] Les deux premières parties de ce texte reprennent des éléments de l’article « L’enseignement mathématique dans le primaire et le secondaire » de Renaud d’Enfert et Hélène Gispert, paru dans l’ouvrage Une histoire de l’école. Anthologie de l’éducation et de l’enseignement en France XVIIIe –XXe siècle, F. Jacquet-Francillon, R. d’Enfert & L. Lœffel (eds), Retz, 2010.

