Accueil > Histoire de l’école > La France des années 68 - Débats sur l’école
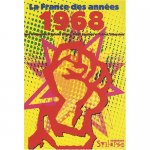 La France des années 68 - Débats sur l’école
La France des années 68 - Débats sur l’école
jeudi 19 février 2009, par
Le mouvement socialiste français a toujours été traversé par une opposition entre deux attitudes face à l’école. Dans la lignée des Lumières, la première tradition fait de l’éducation scolaire un instrument privilégié de l’émancipation individuelle et du progrès social. Mais cette conception se voit bien vite objecter que l’institution scolaire ne peut pas être réellement démocratique dans une société qui ne l’est pas non plus et que l’école de la bourgeoisie relaie au contraire sa domination de classe.
Depuis le Front populaire, la gauche est toutefois assez largement rassemblée, au-delà des désaccords stratégiques persistants, autour de la défense de l’école républicaine et de l’exigence de la démocratisation scolaire, portée après la Libération par le plan Langevin-Wallon de 1947. Jusqu’aux années soixante, cette dernière est conçue par la plupart des syndicats et des partis progressistes à travers des réformes d’ouverture et d’unification de l’enseignement secondaire, qui rendraient les destinées scolaires des élèves indépendantes de leurs origines sociales pour les indexer uniquement sur leurs souhaits, leurs aptitudes et mérites individuels. L’explosion scolaire, dès les années cinquante, puis l’avènement d’un nouveau régime de scolarisation sous la Vème République (Terrail, Poullaouec, 2004) vont cependant susciter de nouvelles critiques radicales de l’école, focalisées sur cet idéal de l’égalité des chances.
Le nouveau visage des inégalités scolaires
Rétrospectivement, l’ampleur et le retentissement des débats scolaires dans les années soixante et soixante-dix ne peuvent tout à fait se comprendre sans tenir compte du coup de tonnerre qu’a pu constituer la révélation publique des inégalités de performances scolaires selon l’origine sociale, alors même que les études s’allongent considérablement, y compris dans les classes populaires, et que se met progressivement en place une école unique ouvrant en principe à tous le droit aux meilleures trajectoires scolaires. D’un côté, il y a plus d’étudiants à l’université en 1978 que d’élèves dans les lycées et les collèges en 1948. De l’autre, en 1962, seulement 28% des enfants d’ouvriers sont jugés par leurs instituteurs en bonne ou excellente réussite scolaire en CM2, contre 55% des enfants de cadres supérieurs (INED, 1970). La prolongation générale des scolarités s’accompagne ainsi du maintien d’inégalités précoces de parcours scolaires entre les élèves des différentes classes sociales. Si les études statistiques de démographie scolaire fournissent bien la première mesure d’ensemble des inégalités de valeur scolaire, c’est la mise en perspective sociologique proposée par Bourdieu et Passeron dans Les Héritiers (1964) qui fait connaître à une large échelle la profondeur des processus de sélection et d’élimination scolaire à l’œuvre dans une école pourtant officiellement méritocratique : « Un fils de cadre supérieur a quatre-vingt fois plus de chances d’entrer à l’université qu’un fils de salarié agricole et quarante fois plus qu’un fils d’ouvrier » (p. 12).
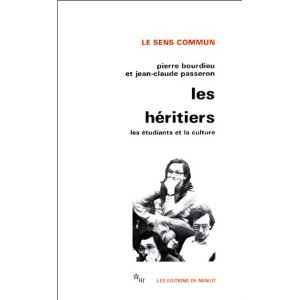
Pour les deux sociologues, il ne s’agit pas principalement d’une inégalité extérieure à l’école, qui serait d’abord imputable aux disparités sociales de fréquentation d’un système scolaire longtemps cloisonné entre un réseau d’écoles communales scolarisant les enfants du peuple au mieux jusqu’au certificat d’études primaires et un réseau de lycées menant les enfants de la bourgeoisie au baccalauréat et à l’université. Selon eux, les mécanismes inégalitaires sont à l’inverse inscrits au cœur des fonctionnements culturels d’un système scolaire qui n’est que formellement égalitaire : leurs travaux dénoncent tout à la fois l’emprise de la « pédagogie implicite », le contenu « aristocratique » de la culture scolaire et « l’indifférence aux différences » affichée par l’école qui désavantagent les élèves d’origine populaire. Ils mettent ainsi le doigt sur la question centrale que pose l’école unique pour la démocratisation de l’accès aux savoirs : l’important n’est plus tant d’égaliser les conditions d’entrée dans tel ou tel segment du système scolaire, mais surtout de réduire, au moyen d’une « pédagogie rationnelle », les inégalités d’acquis intellectuels réalisés tout au long de leurs parcours scolaires par des élèves issus de familles inégalement distantes de la culture savante valorisée à l’école.
« Les ‘‘dons’’ n’existent pas » (Sève, 1964)
L’idéologie de « L’école libératrice » (défendue dans la revue éponyme du Syndicat National des Instituteurs) est ainsi démentie par la description de « L’école conservatrice ». À divers degrés, ces conclusions s’inscrivent aussi en faux contre les analyses politiques de gauche, développées notamment au PCF par Cogniot, qui attribuent principalement les inégalités de résultats scolaires à la pauvreté matérielle et financière des familles ouvrières, et en particulier à leurs mauvaises conditions de logement. Au moment où les données statistiques établies par Clerc en 1964 montrent qu’à niveau égal d’instruction des parents « le revenu n’a pas d’influence propre sur la réussite scolaire » (INED, 1970), Bourdieu et Passeron mettent à jour eux aussi le rôle primordial de « l’héritage culturel » transmis par la famille, et en particulier de « l’habileté à parler ou à écrire » exigée par l’école. Ils rejoignent ainsi la critique de l’idéologie des dons avancée chez les enseignants par le Groupe Français d’Éducation Nouvelle et au PCF par le philosophe Sève. Contre la croyance commune en l’existence de capacités cognitives biologiquement déterminées, héréditaires et inégales qui expliqueraient dès la naissance les performances intellectuelles des uns et l’échec scolaire des autres, Sève démontre que l’intelligence n’est pas une substance dont chacun disposerait en quantité et en qualité variable en venant au monde.

Loin d’être des données naturelles, les facultés intellectuelles sont le produit d’une activité sociale susceptible d’évolution tout au long de l’histoire particulière de chaque être humain confronté à l’appropriation du patrimoine culturel de l’humanité : on ne naît pas bon ou mauvais élève, on le devient. Quand bien même les particularités physiologiques du cerveau humain conditionneraient les activités intellectuelles, Bourdieu et Passeron (1964) ajoutent pour leur part qu’il n’y aurait pas de raison « pour que les hasards de la génétique ne distribuent pas également ces dons inégaux entre les différentes classes sociales » (p. 103). Plus fondamentalement, la sociologie doit dévoiler la fonction de légitimation des divisions sociales que remplissent non seulement l’idéologie des dons mais aussi le mythe de l’égalité des chances : l’école naturalise et justifie les inégalités sociales à travers ses verdicts scolaires en dissimulant les héritages culturels de classe derrière des « dons » ou des « mérites » individuels. Progressivement, Bourdieu et Passeron mettent ainsi l’accent sur la participation déterminante de l’école à « la reproduction » des rapports de classe (1970). Ce faisant, l’idée d’une « démocratisation de l’enseignement par la rationalisation de la pédagogie » devient à leurs yeux utopique et les savoirs transmis par l’école sont de plus en plus réduits à un « arbitraire culturel » des classes dominantes.
« L’école capitaliste en France » (Baudelot, Establet, 1971)
L’essor de la scolarisation prolongée de masse et le poids de plus en plus déterminant des diplômes dans les parcours professionnels vont confirmer sur la longue durée la pertinence de nombreux apports de Bourdieu et Passeron, et notamment l’importance du « capital culturel » dans les sociétés capitalistes contemporaines. Ces constats conduisent Baudelot et Establet à interroger plus avant le rôle de l’appareil scolaire dans la reproduction des rapports sociaux de production. Contestant que l’école transformée par plus d’une décennie de réformes gaullistes soit réellement unique, ils distinguent deux réseaux de scolarisation séparés et étanches qui divisent dès le primaire les scolarités en deux types de parcours : les filières menant de l’école primaire à l’enseignement professionnel scolarisent la majeure partie des enfants d’ouvriers et les conduisent au salariat d’exécution, tandis que les voies du secondaire au supérieur restent réservées aux enfants de la bourgeoisie destinés à occuper les postes de commande de l’économie capitaliste. Baudelot et Establet insistent aussi sur les deux modes de socialisation scolaire qui opposent ces deux réseaux. La même idéologie dominante y est inculquée, mais sous deux formes différentes.
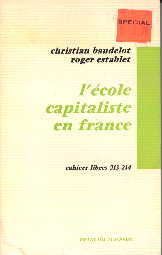
Là où les premiers doivent se soumettre à la culture bourgeoise et se défaire de leur culture prolétarienne, les seconds sont formés à être des « interprètes actifs de l’idéologie bourgeoise ». Très inspirés des travaux d’Althusser sur les « Appareils Idéologiques d’État » et fortement marqués par la « Révolution Culturelle » chinoise, Baudelot et Establet rejoignent aussi certaines positions de l’Internationale communiste sur l’école dans l’entre-deux-guerres. Ils relativisent ainsi l’autonomie des savoirs scolaires par rapport à l’idéologie bourgeoise, en soulignant que l’école ignore et neutralise justement dans ses contenus d’enseignement la différence entre la connaissance objective et l’idéologie dominante. Ils mettent aussi en avant le rôle déterminant de l’école dans la division de la société en classes, en s’appuyant sur le clivage jugé fondamental entre le travail manuel et le travail intellectuel. Leurs analyses dénoncent enfin « le refoulement, l’asservissement et le travestissement » de l’idéologie et de la culture « prolétarienne » des enfants d’ouvriers opérés par l’appareil scolaire bourgeois. Ce point de vue conduit logiquement Baudelot et Establet à valoriser les expériences de contre-enseignement prolétarien refusant la séparation d’avec le travail productif. Certains mouvements étudiants radicaliseront concrètement une analyse assez voisine. Ainsi, peu après Mai 68 et toujours en référence à la Révolution culturelle en Chine, des militants maoïstes de la Gauche Prolétarienne tentent physiquement de bloquer le fonctionnement de l’université, qu’ils considèrent comme un lieu essentiel de production de l’idéologie bourgeoise.
« Faut-il détruire l’école ? »
Bien que très différente, ces approches font ainsi parfois écho aux réflexions de certains mouvements pédagogiques prônant la « déscolarisation de la société » (Illich, 1971) ou le développement d’écoles autogérées et de pédagogies antiautoritaires (Neill, 1970). Pourtant déjà relativement anciennes, ces conceptions rencontrent un succès important dans les années soixante-dix, non seulement à la faveur de l’exigence générale d’autodétermination et de la contestation de l’oppression familiale portées par mai 1968, mais aussi en raison des difficultés cognitives rencontrées par les nouveaux publics de l’école unique face aux pédagogies traditionnelles. Critique de la société de consommation et des bureaucraties, mais peu sensible aux rapports de production, Illich accuse l’école de « produire des élèves dociles prêts à obéir aux institutions » et propose l’instauration, en lieu et place du monopole de l’institution scolaire, d’un système de « bons éducatifs » permettant à chacun d’accéder librement à des réseaux d’informations, de communication et d’échange des connaissances. Quant à l’école fondée en 1921 par Neill à Summerhill, elle est centrée sur l’auto-organisation démocratique de la vie en communauté : les cours sont facultatifs et les activités des enfants sont guidées par leur propre intérêt et leur plaisir ludique.
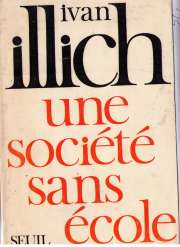
En valorisant une éducation non répressive et non directive qui mise sur l’aspiration à l’autonomie de l’enfant, ces analyses rompent avec les conceptions traditionnelles de la pédagogie de l’inculcation, (telle qu’elle est conçue par exemple chez Durkheim), et souvent à juste titre, tant il est vrai qu’on n’apprend jamais que par soi-même. Elles entrent aussi en affinité avec les principes d’éducation familiale des nouvelles classes moyennes salariées, centrés sur l’épanouissement personnel de l’enfant. Mais elles s’exposent dans le même temps au reproche de minimiser tantôt l’importance du savoir comme arme d’émancipation, tantôt la spécificité historique de l’institution scolaire dans la transmission du savoir. Pour Neill en effet, l’instruction ne pèse que peu de chose par rapport au bonheur des enfants. Mais en refusant d’accepter la pénibilité du travail intellectuel, on renonce aussi aux joies et à l’autonomie que celui-ci peut procurer. Pour Illich, c’est la vie elle-même qui devrait faire école, sans que la raison d’être de l’institution scolaire ne soit chez lui reliée à l’histoire des sociétés. Or, quelles que soient les diverses missions assignées à l’école et les fonctions sociales très variables qu’elle a pu remplir, son extension historique ne se comprend pas sans identifier la fonction irremplaçable qu’elle assume dans l’appropriation et l’étude systématique de la culture écrite (Terrail, 2002).

L’héritage des débats
Avec le recul, il est frappant aujourd’hui de constater que ces débats des années soixante et soixante-dix n’accordent que peu d’importance aux rapports sociaux de sexe à l’école. Longtemps silencieuse et encore inachevée, la formidable progression des scolarités féminines est pourtant tout à fait contemporaine de tous ces travaux sur les inégalités sociales de scolarisation. Il a fallu attendre la fin des années quatre-vingt, dans le prolongement des recherches sur les réussites scolaires improbables, pour que la sociologie de l’éducation prenne la vraie mesure de ce renversement historique des inégalités scolaires entre les sexes. Plus généralement, les analyses de l’époque ont largement tendance à sous-estimer ou même à ignorer les potentialités émancipatrices de la scolarisation. Chez beaucoup d’enseignants, les thèses sur l’inégale distance à la culture scolaire viennent par ailleurs alimenter confusément l’idée fataliste du « handicap socioculturel » pour expliquer les difficultés scolaires des enfants du peuple. À société de classe, école de classe ? Ces débats sur l’école ont insisté à bon droit sur la pertinence du constat, mais sans trop explorer sa réciproque : aucune société ne sera vraiment démocratique tant que l’école ne le sera pas non plus, et ce qui est vrai aujourd’hui le sera aussi demain. Toutefois, grâce aux résultats cumulatifs établis et aux outils d’analyse développés, mais surtout par la richesse et l’étendue des questionnements, les analyses de l’école menées dans les années soixante et soixante-dix s’avèrent encore aujourd’hui incontournables pour penser les conditions d’une levée des obstacles aux apprentissages scolaires.
Tristan Poullaouec
Contribution à La France des années 1968 (Artous, Epsztajn, Silberstein, éditions Syllepse, 2008)
Bibliographie
Baudelot, Establet, L’école capitaliste en France, Maspéro, 1971
Bourdieu, Passeron, Les Héritiers, Minuit, 1964
Bourdieu, Passeron, La Reproduction, Minuit, 1970
Illich, Une société sans école, Seuil, 1971
INED, « Population » et l’enseignement, PUF, 1970
Ligue Communiste, L’école de Jules Ferry est morte, Maspéro, 1974
Neill, Libres enfants de Summerhill, Maspéro, 1970
Sève, « Les ‘‘dons’’ n’existent pas », L’École et la Nation, 1964, repris in GFEN, L’échec scolaire. « Doué ou non doué » ?, Éditions sociales, 1974
Terrail, De l’inégalité scolaire, La Dispute, 2002
Terrail, Poullaouec, « École et divisions sociales », in Bouffartigue, Le retour des classes sociales, La Dispute, 2004

