Accueil > Notes de lecture > La compétence métalangagière, clé de la réussite scolaire
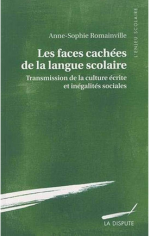 La compétence métalangagière, clé de la réussite scolaire
La compétence métalangagière, clé de la réussite scolaire
Une linguiste dans l’intimité de la communication pédagogique
jeudi 25 avril 2019, par
Le livre d’Anne-Sophie Romainville, Les faces cachées de la langue scolaire. Transmission de la culture écrite et inégalités sociales (La Dispute, coll. L’enjeu scolaire, mai 2019), est un ouvrage qui comptera.
La recherche dont il est tiré s’appuie sur un travail d’observation approfondi très original, mené dans sept classes du secondaire réparties sur trois niveaux (5ème, 3ème et 1ère) et représentant trois types de parcours scolaires (enseignement général dans un bon établissement, dans un établissement moyen, et enseignement professionnel) [1]. Son objectif est d’évaluer la « compétence métalangagière » des élèves et les conditions de sa formation et de son développement par l’institution scolaire. Le grand intérêt de l’entreprise tient tant aux constats réalisés, jamais effectués jusque-là, qu’aux enseignements qu’on peut en tirer, concernant notamment le rôle crucial de la compétence métalangagière dans le parcours scolaire, la relation entre les exigences professorales et la réussite ou l’échec, les orientations didactiques les plus favorables à la réussite. C’est ce que nous nous proposons d’examiner ici.
La recherche et ses constats
En figeant les énoncés sous une forme visible et durable, l’écriture donne le temps d’un examen attentif et réfléchi. Le développement historique de son usage a favorisé l’émergence d’une posture lettrée d’analyse réflexive du langage ; et c’est à cette posture critique qu’est redevable l’essor de la pensée savante, philosophique et scientifique.
Pour s’approprier aujourd’hui les savoirs scolaires issus de cet essor, les élèves doivent, au premier chef, faire leur une même approche réflexive des énoncés, ceux qu’ils ont à lire comme ceux qu’ils ont à écrire. Il leur faut, pour reprendre la formule d’Anne-Sophie Romainville, se doter d’une compétence métalangagière.
Inspirée par les travaux de Jack Goody [2], c’est une recherche de Bernard Lahire (Culture écrite et inégalités scolaires, PUL, Lyon) qui avait mis en évidence en 1993 combien l’échec scolaire tenait effectivement à la difficulté, manifeste chez les élèves des milieux populaires, d’accéder à une posture distanciée et objectivante à l’égard des énoncés langagiers. Cette thèse a marqué l’histoire de la connaissance des processus éducatifs. Largement reconnue et reprise sous des formes diverses, elle était restée néanmoins sans développement ultérieur spécifique. C’est chose faite avec le livre d’Anne-Sophie Romainville.
Lahire avait enquêté sur l’enseignement primaire, comparant les performances scolaires des « héritiers » qui arrivent à l’école prédisposés à l’adoption de la posture métalangagière, et celles des enfants des classes populaires, qui éprouvent les plus grandes difficultés à se départir d’un usage du langage beaucoup plus exclusivement communicationnel. Prolongeant sa démarche, Romainville en enrichit sensiblement la problématique. Elle s’intéresse au secondaire, ce qui lui permet d’interroger les effets des années de scolarisation antérieures sur les élèves les moins préparés, au départ, à une approche réflexive des énoncés. Qui plus est, à la différence de Lahire, elle contraste des parcours scolaires au public socialement différencié. Elle se met ainsi en position d’évaluer les modifications de la conduite des apprentissages et des niveaux d’exigence en fonction des publics d’élèves, et d’interroger en retour l’impact des pratiques enseignantes sur la formation de la compétence métalangagière.
La chercheure a passé trois semaines dans chacune des huit classes de l’échantillon, enregistrant l’ensemble des interactions pédagogiques (écrites et orales) dans les cours de français et d’histoire-sciences humaines. Ce matériau considérable a ensuite été systématiquement analysé et ventilé en interactions d’ordre « conversationnel » (dans lesquelles l’enseignant se contente de faire appel à l’intuition ou aux connaissances préalablement mémorisées des élèves) et interactions d’ordre « scriptural » (impliquant de la part des élèves l’adoption d’une posture réflexive, métalangagière). Elle a sélectionné en outre quelque 4 élèves par classe jugés représentatifs de cette dernière, 29 au total sur les 148 concernés par l’enquête, pour une investigation approfondie des modalités de leur entrée dans la culture écrite et de leur profil de « scripteurs » (analyse précise de leurs prestations scolaires, tests écrits et interviews, observations rapprochées de leur comportement en classe et lors des tâches d’écriture et de lecture, reconstitution de leur trajectoire sociale et de leur histoire scolaire).
Ce « terrain » particulièrement chargé, on le voit, donne beaucoup de crédibilité aux résultats obtenus. Évoquons-les brièvement, avant de revenir plus précisément, sous différents aspects, sur la portée des constats opérés. Ces derniers sont essentiellement de trois ordres. L’analyse des performances des élèves montre, d’une part, l’œuvre positive de la scolarisation qui a permis à une majorité d’entre eux d’accéder, bien qu’à des degrés très divers, à une forme de compétence métalangagière. Le décompte des interactions maître/élèves, d’autre part, permet de souligner que si le registre du conversationnel est présent dans toutes les formes de conduite des apprentissages, c’est dans des proportions très inégales : il est d’autant plus utilisé que le public d’élèves est plus populaire ; et son usage n’a pas nécessairement la même fonction pédagogique dans les « bonnes classes » et dans les filières dévalorisées. Enfin l’analyse fine des interactions montre que les enseignants des filières moins valorisées ont tendance, là même où leurs exigences (imposées par le respect des programmes) relèvent apparemment du scriptural, à permettre à leurs élèves de les contourner, en leur fournissant implicitement les moyens d’y répondre par simple recours à l’intuition ou à la mémorisation.
La formation de la compétence métalangagière, si l’on préfère, est l’objet de soins attentifs dans les établissements et les classes où se concentrent les « héritiers » ; elle est négligée dans les autres, où l’on permet aux élèves, au nom d’un enseignement « adapté », d’échapper à ses contraintes. Cette recherche confirme ainsi, de belle manière, combien la norme du donner moins à ceux qui ont moins infiltre les pratiques enseignantes au plus intime.
Son auteure souligne en conclusion combien la démocratisation de l’accès aux savoirs est suspendue à la rupture avec une telle norme, et donc à la mise en œuvre d’une pédagogie de l’exigence intellectuelle pour tous. Elle avance en ce sens, à partir des séquences qu’elle a pu observer in situ, une série de suggestions didactiques visant à permettre la généralisation d’une véritable formation de la compétence métalangagière à l’école.
Quelques enseignements de la recherche
La formation de la compétence métalangagière
Dans sa recherche, Bernard Lahire avait souligné combien la formation et la mise en œuvre de la capacité des élèves à considérer les réalisations langagières en elles-mêmes et pour elles-mêmes constituaient le réquisit central de l’enseignement primaire. Il décrivait en regard l’opposition entre les élèves qui parvenaient à entrer dans un rapport objectivant, surplombant, au langage, et à satisfaire à ce réquisit ; et ceux qui restaient pris dans un rapport oral, de communication directe et peu réflexif, aux énoncés. D’observer ses enquêtés plus tard, dans l’enseignement secondaire, permet à Anne-Sophie Romainville d’interroger cette opposition : reste-t-elle aussi dilemmatique après quelques années de scolarisation ?
Pour répondre à la question, elle s’attache à regrouper les élèves enquêtés selon la qualité de leurs performances rédactionnelles, scripturaires. La typologie à laquelle elle aboutit est toujours polarisée, de fait, par une opposition nette entre deux groupes d’élèves, ceux d’une part qui ont suffisamment intériorisé les exigences métalangagières au point qu’ils y répondent de façon quasi naturelle, en adoptant comme sans y penser un rapport toujours réfléchi à ce qu’ils écrivent, et ceux d’autre part qui peinent à en imaginer même l’existence.
Mais ses investigations permettent deux autres constats, qui l’amènent à distinguer deux aspects de la compétence métalangagière. Il s’agit d’abord du versant « métalinguistique » de cette compétence, celui qui concerne la maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe, des codes donc du maniement de la langue écrite. Connaître les codes est une chose, cependant, s’en servir en est une autre, qui met en jeu la maîtrise réflexive, « scripturale », de la construction du discours, écrit ou oral : c’est là le domaine du « métadiscursif », second versant de la compétence métalangagière. Or si le groupe des meilleurs élèves manifeste une compétence métadiscursive affirmée, à l’autre pôle celui des « scripteurs » les plus faibles fait preuve d’une formation au moins minimale de la compétence métalinguistique : la scolarité n’a pas été totalement sans effets pour eux. Et par ailleurs Anne-Sophie Romainville relève la présence, entre ces deux groupes polaires, de deux types intermédiaires de scripteurs, dont les performances manifestent l’intégration, même maladroite, de certaines exigences métadiscursives.
Ces constats sont éclairants. Si l’apprentissage du lire-écrire est un moment décisif de l’entrée dans la culture écrite, l’appropriation de cette dernière dépend de l’usage du savoir faire ainsi acquis. On pense ici à l’enquête classique de Scribner et Cole menée chez les Vaï du Libéria et qui a montré, à la surprise de chercheurs pénétrés des travaux de Vygotski et Goody, que l’écriture n’avait pas de « conséquences cognitives générales » : seule une véritable scolarisation, au-delà de la simple acquisition du maniement des signes graphiques, provoque les changements cognitifs (dans le rapport au monde et au langage) qui accompagnent l’entrée dans la culture écrite [3].
On comprend dès lors pourquoi l’opposition entre lettrés et non lettrés, entre ceux à qui la posture scripturale est devenue familière et ceux qui ne se départissent pas d’un rapport oral au langage, est à la fois très heuristique dans son principe et insuffisante à décrire la réalité. L’école ne se contente pas d’habituer ses publics au maniement des signes graphiques : elle s’attache à développer la connaissance lexicale et grammaticale de la langue (compétence métalinguistique), elle introduit aux disciplines savantes, et ce faisant elle invite les élèves à interroger le sens des phrases, à construire et déconstruire les textes (compétence métadiscursive). Les enfants scolarisés n’entrent pas d’un coup dans la culture écrite, ils se l’approprient progressivement. La formation de la compétence métalangagière apparaît ainsi logiquement inhérente à la durée et à la qualité du processus de scolarisation. Les différenciations de ce dernier dotent les publics scolaires d’« habitus langagiers » différents, pour reprendre la formule d’Anne-Sophie Romainville, formule qui évoque les observations de Jean-Marie Privat sur l’intérêt de distinguer des « degrés de littératie », ou de Yves Reuter qui appelle à conjuguer la notion de « cultures de l’écrit » au pluriel [4].
L’inégal développement des compétences métalangagières avait également été relevée par Fanny Renard dans sa thèse de 2007 concernant les performances littéraires des lycéens français [5]. Celle-ci observait que certains élèves semblaient n’avoir appris avant leur entrée en seconde qu’à réaliser des lectures de textes d’ordre « pragmatique », manifestant ainsi un développement insuffisant de leurs compétences métadiscursives. La recherche d’Anne-Sophie Romainville confirme ce constat, et l’éclaire par l’examen de la différenciation des pratiques enseignantes en fonction des publics d’élèves concernés.
La portée générale de la compétence métalangagière
C’est en linguiste, on l’aura compris, qu’Anne-Sophie Romainville aborde les processus d’apprentissage et les formes de leur conduite. Elle ne s’intéresse pas aux connaissances acquises dans les disciplines observées, à leur qualité et à leur évaluation par les enseignants. Elle interroge la communication pédagogique sous l’angle exclusif du mode langagier (conversationnel/scriptural) qu’elle met en œuvre. Le choix de ce prisme s’avère particulièrement fructueux.
Il lui permet en effet de confirmer de façon convaincante la thèse centrale qui soutenait la recherche de Bernard Lahire, selon laquelle l’exigence d’accès à la posture scripturale, à un rapport réflexif aux énoncés langagiers, se trouve au cœur des attentes de l’école à l’égard de ses publics. De fait, en sériant les « degrés de littératie » auxquels sont parvenus les élèves de son échantillon, elle peut observer combien ces degrés sont associés à la valeur scolaire générale, transdisciplinaire, des intéressés. Plus les enquêtés font preuve d’une compétence langagière développée, en effet, plus ils se montrent « bons élèves » de façon générale. Et si les quatre types de scripteurs qu’elle différencie correspondent à la hiérarchie des valeurs scolaires, c’est que « les compétences scripturales affectent l’ensemble des disciplines et des types d’apprentissage ». Sans doute tient-on là une indication précieuse.
La recherche sociologique a pu montrer, au long du dernier demi-siècle, l’impact de la formation initiale sur bien des types de pratiques. C’est bien sûr le cas des différentes formes de consommation culturelle : mais le degré de scolarisation exerce aussi ses effets sur nombre d’autres activités dans le champ des loisirs et de la vie familiale, comme sur les rapports au travail professionnel. Certes, dans chaque domaine d’activité, les goûts, les réactions, les choix sont soumis à des déterminations différentes, l’âge et la génération, le sexe, le milieu socioprofessionnel, l’appartenance religieuse, etc. Il est néanmoins frappant que bien souvent, dans une multitude d’enquêtes, la durée de scolarisation s’avère en dernier ressort le facteur le plus distinctif des comportements observés. Cela reste vrai de choix existentiels cruciaux comme la fécondité, qui dépend de multiples conditions, parmi lesquelles cependant la scolarisation des femmes est toujours une donnée centrale [6].
C’est tout un rapport au monde, si l’on préfère, que modifie la formation initiale. Cette modification est certainement redevable à l’intégration et à l’accumulation d’un ensemble de connaissances positives, qui soutiennent une diversité de compétences existentielles. Mais ne doit-elle pas beaucoup aussi à la systématisation de la posture scripturale ? Certes les spécialisations disciplinaires ne peuvent pas ne pas avoir d’influence propre sur tels ou tels types de comportements. Mais leur effet spécifique n’annule pas l’impact général de la durée de scolarisation considérée en elle-même. Cette dernière étant un indicateur du développement de la compétence métalangagière, ne faut-il pas penser que si la scolarisation change le rapport au monde, c’est d’abord parce qu’elle change le rapport au langage ?
L’échec scolaire tient-il à la hausse des exigences de l’école ?
Didacticien des sciences, Samuel Johsua s’intéresse, dans un ouvrage de 1999, à l’évolution historique des exigences scolaires. Celles-ci ont été marquées dans une très large mesure jusqu’à ces dernières décennies, relève-t-il, « par une logique de la restitution. Ce dont rendent compte les images, si fortement ancrées dans les réminiscences collectives, du rôle ’transmissif’ des maîtres, de la prédominance de la ’mémoire’ et du ’par cœur’ (…) ». Mais « à la logique de la restitution se substitue peu à peu une logique de la compréhension. On souhaite que le travail du savoir par les élèves se traduise dans des signes tangibles de ’compréhension’, dépassant les traits de surface et la correspondance formelle de la restitution. Le ’copier-déchiffrer’ sera considéré comme dépassé, ou insuffisant. Il va falloir désormais ’rédiger-comprendre’ (…) l’attention est alors portée sur le pôle de la ’mise à distance’ » [7].
Certes Samuel Johsua traite l’opposition restitution/compréhension de façon nuancée. La logique de la restitution, qui met pourtant l’accent « sur l’adéquation des productions des élèves à des « modèles » le plus clairement délimités possible », laisse nécessairement selon lui une place à la réflexion critique, dont « la réélaboration individuelle des savoirs est toujours le signe comme le moyen, qu’on la recherche consciemment ou pas » [8]. Quant à l’exigence de compréhension qui lui succède, elle n’est pas elle-même dénuée d’ambiguïté : qu’entend-on par « compréhension » des objets de savoir, jusqu’où le processus d’intellection doit-il être mené ? L’exigence de compréhension ouvre nécessairement en ce sens une zone d’incertitude, ouverte à « la négociation entre le maître et ses élèves » [9].
Compte tenu de ces nuances, la tendance historique n’en reste pas moins, selon Johsua, à la hausse des exigences cognitives de l’école. Ne convient-il pas de lui accorder ce point, tant il paraît inévitable qu’au fil des générations « le niveau monte » [10], celui de l’information, des connaissances et des capacités réflexives, à la mesure de la complexité croissante d’une vie sociale de plus en plus infiltrée par la culture écrite ?
Cette thèse est reprise dans un ouvrage collectif récent, consacré à la comparaison historique de manuels et d’autres types de supports pédagogiques. Dirigé par Stéphane Bonnéry, celui-ci contraste des supports qui, jusqu’aux années 1950-60, proposaient des connaissances explicites et faisaient appel à leur mémorisation, et ceux d’aujourd’hui dans lesquels « le savoir n’est plus donné « clé en main », c’est à l’élève de le découvrir ou plutôt de le construire » [11]. Pour les auteurs le passage de la logique de la restitution à celle de la compréhension contribue au premier chef à la production des inégalités scolaires, les questions et les consignes d’activité peu précises des manuels actuels favorisant inévitablement « les élèves qui ont acquis, hors de l’école, les dispositions requises » [12].
Ce travail de recherche est l’occasion de souligner quelques questions soulevées par la problématique du passage restitution/compréhension.
Il distingue mal, semble-t-il, ce qui relève dans les constats réalisés d’une élévation des exigences cognitives déplaçant l’accent de la mémorisation à la compréhension, et ce qui tient à la faveur nouvelle des pédagogies implicites au détriment des pédagogies « frontales », explicites. Or rabattre ces deux évolutions l’une sur l’autre ne va pas sans introduire quelque confusion dans le propos. Ainsi, comme l’argumente précisément Janine Reichstadt dans une contribution à la discussion de l’ouvrage [13], désigner explicitement les objets de savoir proposés à l’attention des élèves n’implique pas par soi-même de vouer ces objets à la seule mémorisation : savoir où l’on va n’interdit en rien la mobilisation de l’intelligence et un véritable travail de compréhension.
Si une conduite explicite des apprentissages n’est pas contradictoire avec l’exigence d’une posture réflexive, à l’inverse il n’est pas rare qu’une démarche qui se veut « constructiviste » ne puisse aboutir parce que les éléments nécessaires au cheminement logique de la compréhension font défaut. L’invisibilité de l’objectif cognitif peut être insurmontable pour les élèves et n’est en rien, comme le remarque J. Reichstadt à partir d’un exemple précis tiré de l’ouvrage, la marque d’un enseignement ambitieux. Les pédagogies invisibles ne sont pas forcément plus exigeantes que les pédagogies explicites : « Le difficile, note-t-elle, n’est pas l’inintelligible ».
Les constats réalisés par Anne-Sophie Romainville au fil de sa recherche éclairent sérieusement les termes de ce débat. Toutes ses observations concernant la pédagogie pratiquée dans l’établissement « bourgeois » montrent autant d’incitations au développement de la compétence métadiscursive des élèves, à l’adoption d’une posture réflexive à l’égard des énoncés, et confirment ainsi combien la logique de la « compréhension » imprègne effectivement aujourd’hui de façon dominante la pédagogie pratiquée à l’égard des « héritiers ». Mais la mise en œuvre de cette logique ne semble pas devoir grand-chose aux principes des pédagogies invisibles et constructivistes : les enjeux de savoir et les cheminements pour les atteindre y sont très explicitement désignés. Ce qui confirme, là, que l’invisibilisation des objets d’apprentissage est une chose, l’exercice d’une véritable exigence intellectuelle en est une autre.
Qu’en est-il enfin de la pédagogie pratiquée à l’égard des publics plus populaires ? Le niveau d’exigence pratiqué par les enseignants s’abaisse à mesure que se dégrade la qualité sociale des publics. Certes, comme le remarque Anne-Sophie Romainville, les apparences peuvent être trompeuses : les programmes et les manuels, destinés à tous les publics, participent beaucoup moins à cette baisse et maintiennent de réelles exigences de posture réflexive et critique. Mais les enseignants concernés anticipent les difficultés de leurs élèves à y faire face et leur fournisse sans le dire vraiment les moyens de les contourner, en sorte qu’ils puissent satisfaire aux tâches prescrites par les seuls moyens de l’intuition et de la mémorisation.
On voit ainsi que la hausse historique du niveau d’exigence est une réalité… pour une partie des élèves. Elle ne concerne pas, ou peu, les non « héritiers » qui restent largement confrontés à des impératifs de mémorisation et de restitution. En ce sens il apparaît très contestable de soutenir que la hausse des inégalités scolaires est redevable « à la complexité croissante de l’activité intellectuelle que les élèves sont tenus de réaliser » [14]. C’est l’inverse que vérifie Anne-Sophie Romainville : c’est bien parce qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes exigences que les « héritiers » que les enfants des classes populaires voient se creuser l’écart qui les sépare de ces derniers.
[1] L’enquête a été menée en Belgique francophone, et il n’y a aucune raison de penser qu’elle aurait conduit en France à des conclusions très différentes.
[2] Voir notamment Jack Goody, La Raison graphique, Minuit, Paris, 1979 ; et Savoirs et pouvoirs de l’écrit, La Dispute, Paris, 2007.
[3] Sylvia Scribner et Michael Cole, The Psychology of Literacy, Harvard University Press, Cambridge, 1981. On trouvera un commentaire de cette recherche in Jean-Pierre Terrail, Entrer dans l’écrit, La Dispute, Paris, 2013, pp. 108 et suiv.).
[4] Voir les contributions de ces chercheurs à la revue Pratiques, « La littératie. Autour de Jack Goody », n°131-132, Metz, 2006.
[5] Fanny Renard, Les lectures scolaires et extra-scolaires de lycéens : entre habitudes constituées et sollicitations contextuelles, Université Lumière Lyon 2, Lyon, 2007.
[6] J’évoque cet impact de la scolarisation in Jean-Pierre Terrail, École et émancipation, GRDS, 2013, http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article176#nh16.
[7] Samuel Johsua, L’école entre crise et refondation, La Dispute, Paris, 1999, pp. 113 et 116.
[8] Ibid., p. 113.
[9] Ibid. p. 117.
[10] Voir Christian Baudelot et Roger Establet, Le Niveau monte, Seuil, Paris, 1990.
[11] Voir Stéphane Bonnéry (dir.), Supports pédagogiques et inégalités scolaires, La Dispute, Paris, 2015.
[12] Ibid., p. 182.
[13] Voir Janine Reichstadt, Une école plus inégale parce que plus exigeante ?, GRDS, 2105, http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article215&var_mode=calcul#nh4 .
[14] Stéphane Bonnéry (dir.), Supports pédagogiques et inégalités scolaires, op. cité.

