Accueil > École commune > Éléments de discussion > Un lycée unique ? Le GRDS lance la discussion
 Un lycée unique ? Le GRDS lance la discussion
Un lycée unique ? Le GRDS lance la discussion
samedi 18 décembre 2010, par
Depuis novembre 2010, on voit la question de l’école, et plus particulièrement des inégalités scolaires, revenir en force, c’est peu dire, sur la scène publique. Le débat est lancé, le GRDS y a contribué à sa mesure, l’Appel des 50 chercheurs a eu un petit effet d’électrochoc, c’est un bon début, et le contexte de la présidentielle se prête à ce qu’on ne s’en tienne pas là. On va enfin pouvoir associer les luttes pour la défense d’un service public d’éducation doté des moyens humains et financiers adéquats à une réflexion de fond sur la façon de mettre ces moyens au service d’une démocratisation ambitieuse de notre système éducatif. Tracer des perspectives et passer à l’offensive.
Nous n’en sommes qu’au début du débat public, et pourtant se dessine déjà une ligne de démarcation essentielle.
1/ En ligne de mire, référence majeure à l’égard de laquelle tous les intervenants sont obligés désormais de se prononcer, la politique dite « du socle commun de compétences ».
Nous estimons, au GRDS, que la signification essentielle de cette politique est de prendre acte de la situation actuelle du collège unique pour l’aménager au mieux des intérêts patronaux. Le dit « collège unique » rassemble aujourd’hui, à niveau scolaire donné, des jeunes dont les acquisitions cognitives effectives présentent des écarts vertigineux. La situation est suffisamment intenable pour qu’une majorité d’enseignants, a fortiori s’ils enseignent au collège, estiment que l’institution du collège unique en 1975 était un pari utopique. Plutôt que de renoncer à cette institution, ce qui serait politiquement difficile vu la force des attentes populaires à l’égard de l’école, la politique du socle commun, décidée à l’échelle européenne, préfère l’aménager de façon assez habile.
Habile pour au moins trois raisons. D’abord parce qu’elle ne touche pas les apprentissages fondamentaux, et ne modifiera donc guère les écarts cognitifs entre les élèves. Elle se contente de proposer un vernis d’employabilité aux jeunes qui arrivent au collège après être passé à côté de leur scolarité élémentaire : je sais me mettre en rang, écouter mes camarades avant de prendre la parole, respecter les autres, manipuler un ordinateur et contrôler un écran, dire bonjour en anglais (de Wall Street bien sûr), citer trois événements essentiels dans telle période historique… Année après année, les 150 000 jeunes « en grande difficulté de compréhension de l’écrit » (PISA 2009) continueront d’être livrés sur le marché du travail sans défenses ni qualification, évitant à leurs employeurs d’avoir à investir dans la suppression des postes de travail les moins qualifiés, ce qui n’est tout de même pas dénué d’intérêt ! Deuxième habileté, le socle commun noie le poisson des inégalités avec une certaine élégance : comment continuer à contester la situation et critiquer une école à deux vitesses dès lors que le collège conduit 100% de ses élèves au socle commun ? Le tour de force, ici, c’est de ne pas définir les connaissances correspondant à chaque compétence, en sachant très bien qu’elles ne seront pas tout à fait les mêmes à Henri-IV-Paris-Cinquième et au fin fond des quartiers. Et conjointement, troisième habileté, le socle commun peut emporter l’adhésion d’enseignants découragés, résignés à penser qu’il n’y a pas grand chose à faire avec ces masses de jeunes en difficulté, et qui pratiquent déjà l’« adaptation » à la baisse des programmes en fonction des possibilités présumées de ces jeunes. Ces collègues bénéficieront maintenant de la satisfaction de former des « compétences ».
Ces habiletés ne sont pas sans efficace puisque le principe du socle commun fait pour le moment l’objet d’un consensus relativement large, qui englobe à gauche des organisations politiques et syndicales non négligeables. Ces dernières n’hésitent pas pour se démarquer quelque peu du programme de l’UMP à puiser dans l’arsenal fatigué des belles promesses, et annoncent pour leur part l’école de « la réussite », de « l’épanouissement » pour tous, et tant qu’on y est de « l’égalité des chances », mais sans proposer d’autres objets d’épanouissement aux élèves en difficulté que l’acquisition des susdites compétences.
2/ Quant à ceux qui nourrissent une autre ambition pour l’école que de pousser les inégalités sous le tapis, pour reprendre une expression de Baudelot et Establet, ils sont au pied du mur. Face aux propositions de l’Agenda de Lisbonne, les partisans de la démocratisation scolaire ont besoin de contre perspectives sérieusement argumentées. Il n’est plus possible de s’en tenir à la revendication des moyens de faire tourner correctement une « école unique » qui a eu tout le temps, en quatre décennies, de faire la preuve de ses limites.
Comment donc s’attaquer autrement à la question du collège unique ? Si l’on refuse de prendre acte des inégalités, en les ignorant ou en les aménageant, il n’y a guère qu’une solution, les supprimer. L’on voit d’emblée, ici, que l’autre solution ne peut s’intéresser au seul collège. Elle concerne nécessairement aussi l’amont, parce qu’une entreprise de réduction massive des inégalités passe inéluctablement par une forte amélioration de l’efficacité des apprentissages fondamentaux de l’école élémentaire. Et elle concerne l’aval, parce que des élèves dont la scolarité s’est bien déroulée jusque-là entendent, dans leur quasi totalité, poursuivre au lycée un cursus d’enseignement général. Sortir par le haut de la crise du collège unique pose inévitablement la question du lycée unique.
Récuser la politique du socle commun contraint ainsi à envisager une véritable refondation de notre système éducatif. Nécessairement affectée d’une forte ambition, la seule réponse possible, comme le soutient l’appel des 50 chercheurs, est celle d’une grande réforme démocratique de l’école. Et l’on voit facilement les pierres de touche de cette réforme : amener tous les élèves à s’approprier une culture commune de haut niveau, donc mettre en place un tronc véritablement commun, de la maternelle au lycée, sans élimination en cours de route et donc sans concurrence ; élever considérablement l’efficacité des dispositifs pédagogiques ; impliquer activement la masse des enseignants, sans lesquels rien ne se fera, dans ce processus de transformation.
3/ La perspective d’un grand projet démocratique pour l’école soulève une série de problèmes sur lesquels le GRDS propose que les échanges se développent et nourrissent la réflexion commune.
a/ La question première est celle du degré de réalisme d’une telle perspective. L’alternative qui a paru s’imposer jusqu’ici comme indépassable entre enseignement de masse et enseignement de haut niveau peut-elle être surmontée ? Peut-on sérieusement envisager, si l’on préfère, de faire des 150 000 jeunes qui sortent aujourd’hui de l’école « en grande difficulté de compréhension de l’écrit » des élèves qui ont réussi normalement leur scolarité élémentaire et leurs études au collège, et entendent dès lors poursuivre tout aussi normalement leur parcours dans la voie commune d’un lycée unique ? En ont-ils vraiment les ressources intellectuelles et morales ?
Le « tous capables » du GFEN est volontiers repris par ceux qui prônent « une école de la réussite pour tous ». C’est un beau principe auquel beaucoup d’enseignants voudraient bien adhérer mais auquel très peu accordent un réel crédit. C’est là un obstacle important à toute entreprise de démocratisation scolaire de masse : et l’on ne voit pas comment celle-ci pourrait être engagée s’il n’est pas vigoureusement contrebattu. Il peut l’être à la fois en prenant appui sur des expériences pratiques démontrant la possibilité de faire réussir tous les élèves, comme c’est le cas en matière d’entrée dans le lire-écrire de la mise à l’épreuve d’un manuel de lecture innovant dans douze classes de CP (cf. Les lettres bleues), ou en matière de production de textes dans telle école Freinet (cf. l’enquête de l’équipe d’Yves Reuter) ; et en affrontant parallèlement la nécessaire discussion théorique des ressources dont disposent les élèves les moins pourvus, tel le fils d’un ouvrier analphabète primo arrivant d’une région écartée de la planète.
Dans les années 1960, les travaux de Lucien Sève ou Bourdieu et Passeron, auxquels la presse syndicale enseignante avait donné un fort écho, avaient suscité un grand débat dans la profession : au point que la théorie des dons et autres explications biologisantes de l’échec scolaire avaient significativement relâché leur emprise… pour laisser place, il est vrai, à la théorie tout aussi fataliste du « handicap socioculturel ». On ne peut pas continuer plus longtemps à laisser le champ libre à cette dernière. Sa mise en discussion est théoriquement exigeante, mais en allait-il très différemment pour la croyance dans les dons ? Peu d’analyses critiques lui sont encore consacrées, mais celles qui existent (cf. notamment sur ce site : ici et là) ne devraient-elles pas être soumises à un large débat contradictoire ?
b/ Deuxième grand objet d’investigation et de nécessaire discussion, la substitution à l’actuelle école « unique » de ce qu’on pourrait appeler une école « commune » puisqu’elle procède de la suppression de toute mise en concurrence des élèves et des établissements, et de la mise en place d’un véritable tronc commun. Les questions de la culture commune à transmettre, et des modalités didactiques et pédagogiques de sa transmission, étant traitées à part, bien des thèmes restent à traiter dans cette rubrique.
Un tronc commun non concurrentiel se caractérise par l’absence de redoublement et de notation. Mais non de difficultés d’apprentissage, que certains élèves auront toujours plus de difficultés que d’autres à surmonter selon la discipline. Quel type d’aide complémentaire doit-on envisager de leur apporter, sachant que la vocation de l’école commune n’est pas de trier les élèves, mais de les conduire tous au même point ; et que, jusqu’ici, des GAPP aux RASED, selon les enquêtes disponibles, les dispositifs mis en place n’ont pas réussi à jouer pleinement leur rôle de rattrapage cognitif ? Ce constat appelle à réfléchir à la fois les principes pédagogiques de l’accompagnement des élèves concernés, ce qui ne peut être fait qu’en regard de la rénovation des dispositifs d’enseignement ordinaires, laquelle doit jouer le rôle essentiel dans la confrontation aux difficultés d’apprentissage ; et certaines de ses modalités pratiques : comment ne pas retirer de leur classe les élèves en difficulté dans tel domaine du savoir, leur enseignant ordinaire ne doit-il pas garder la maîtrise du recours à une intervention extérieure et de son contenu, etc.
Supprimer les notes supprime le classement des élèves, mais pas le besoin d’une évaluation formative : comment la concevoir ?
Si l’on admet que le parcours commun commence à trois ans avec l’entrée dans l’école « enfantine », se poursuit à l’école élémentaire avec l’entrée dans la culture écrite, puis au collège et au lycée, à quel niveau s’agit-il d’en fixer le terme ? Porter la scolarité obligatoire à 18 ans paraît aujourd’hui faire consensus parmi les tenants de la démocratisation scolaire, mais suppose déjà une très forte amélioration des apprentissages. Ne serait-ce que pour cette raison, la scolarité obligatoire à 18 ans ne paraît guère conciliable avec un maintien en l’état du dispositif des filières du second cycle, enseignement général, technologique, professionnel. Différentes solutions sont envisageables : un tronc commun allant jusqu’en terminale ; un tronc commun allant jusqu’à la première, et ouvrant en terminale sur quelques grandes options préfigurant les orientations disciplinaires et professionnelles ultérieures ; ou bien un maintien au lycée dès la seconde d’options qui laissent toutefois, et cela jusqu’en terminale, une place importante aux matières de la culture commune. Cette dernière option se démarque clairement des deux précédentes ; le GRDS, pour sa part, n’y adhère pas. Nous considérons en effet que seule la volonté de mener tous les élèves aux mêmes acquisitions cognitives au terme (17 ou 18 ans) du tronc commun, en bannissant donc le moindre soupçon de filière, peut éviter que le choix de telle filière, ou de telle « section » (ces dernières étant inévitablement hiérarchisées, quoiqu’on en ait, comme sont hiérarchisés leurs débouchés professionnels) soit anticipé en amont quasiment jusqu’à la maternelle, comme c’est le cas aujourd’hui, si ce n’est par les familles… mais aussi et surtout par les enseignants.
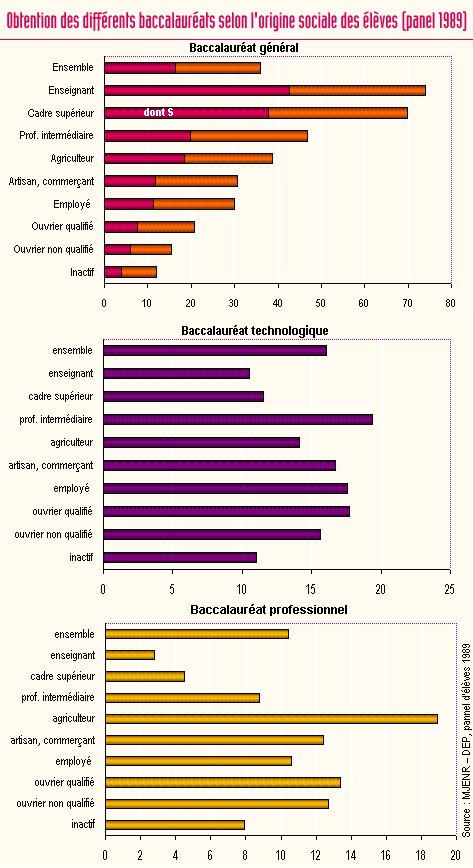
La mise en place d’un tronc commun à 17 ou 18 ans implique la reconversion vers l’aval du cursus commun des dispositifs de formation qui accueillent actuellement les jeunes qui ne réussissent pas à se maintenir dans l’enseignement général ou qui (beaucoup plus rarement) choisissent de l’abandonner. Ces formations se verront appelées à accueillir des élèves qui seront non seulement plus âgés mais aussi autrement formés ; et cela dans un contexte où les métiers concernés connaîtront eux-mêmes des évolutions qu’on a toute raison de penser assez rapides.
c/ La rénovation des dispositifs pédagogiques, en troisième lieu, et la formation des enseignants qui va avec, constituent un moment décisif pour toute l’entreprise.
C’est un point à la fois crucial et particulièrement délicat, puisque les dispositifs d’enseignement qui sont en place aujourd’hui procèdent de la modernisation des années 1970/80, dont bien des aspects ont été mis en place avec l’assentiment, le soutien ou même sous l’impulsion de bien des partisans de la démocratisation scolaire. Le réexamen de ces dispositifs peut être leur apparaître aujourd’hui comme une révision déchirante, injustifiée, voire insupportable. Aussi la discussion doit-elle porter en premier lieu sur le caractère indispensable ou pas de ce réexamen. Puis, par un effort des uns et des autres pour dépasser les polémiques usées et usantes opposant « pédagogues » et « républicains », sur ce qui doit faire l’objet précisément de réexamen dans ces dispositifs, d’une discipline à l’autre, qu’il s’agisse du versant « didactique » de ces dispositifs (quels systèmes d’apprentissages sont-ils les plus assurés et performants ?) ou de leur versant « pédagogique » (comment conduire ces apprentissages ?).
Ce processus de réexamen n’a de chance d’aboutir que si ses participants, plutôt que de partir de positions de principe arrêtées concernant les dispositifs pédagogiques les plus séduisants, les plus conformes à la nature de l’enfant, les plus propices au développement de son intelligence etc., donnent une chance aux constats empiriques, à la validation par l’expérience. Qu’est-ce que donnent dans la pratique les dispositifs séduisants en question ? Pourquoi leur efficacité est-elle limitée au point que, ces dispositifs étant tous pensés en fonction du développement de la « compréhension » de l’enfant, on se retrouve au sortir du primaire avec 150 000 élèves « en grande difficulté de compréhension de l’écrit » ?
On a ainsi une double raison d’inviter les enseignants à jouer eux-mêmes un rôle moteur dans ce réexamen. D’une part c’est leur façon d’exercer leur métier qui est en jeu, et l’entreprise de démocratisation de l’école ne sera elle-même démocratique – et donc efficace – que si elle bénéficie de leur adhésion et de leur contribution active. D’autre part ce sont eux qui sont en première ligne du retour d’expérience, et non qui que ce soit d’autre, parents ou experts en éducation. Ce sont eux qui sont le plus spontanément enclins à adopter le point de vue de la pratique, de l’efficacité pratique, en matière de procédures pédagogiques. Il est vrai en même temps que c’est beaucoup leur demander que de prendre une véritable distance critique à l’égard de leur propre activité, de leur propre savoir faire. Mais ils ont un motif puissant de s’impliquer dans l’affaire : c’est leur bonheur professionnel qui est en cause, à travers la possibilité de reprendre collectivement la main sur leur métier, de faire réussir tous leurs élèves, de restaurer leur rapport à ces derniers et donc de bénéficier d’une amélioration essentielle de leurs conditions de travail.
Encore faut-il établir les conditions de leur implication :
![]() une autonomie professionnelle qui les responsabilise : vous faites comme vous l’entendez, nous ne savons qu’une chose, c’est que vos élèves doivent réussir. L’actuel contrôle a priori doit être remplacé par un contrôle ex post. Le modèle de large autogestion qui a longtemps caractérisé le fonctionnement de l’université française, en héritage des vieilles chartes de franchise, peut ici servir de référence.
une autonomie professionnelle qui les responsabilise : vous faites comme vous l’entendez, nous ne savons qu’une chose, c’est que vos élèves doivent réussir. L’actuel contrôle a priori doit être remplacé par un contrôle ex post. Le modèle de large autogestion qui a longtemps caractérisé le fonctionnement de l’université française, en héritage des vieilles chartes de franchise, peut ici servir de référence.
![]() des conditions de travail qui permettent l’expérimentation, la concertation, l’échange et la circulation de l’information et de la réflexion. L’autonomie dont les enseignants ont besoin est en effet une autonomie collective, pas l’isolement de chacun dans sa classe. A eux, dans le cadre de cette autonomie, de prendre appui sur les chercheurs qui peuvent contribuer à l’observation réfléchie des pratiques, à valider les expériences novatrices, en signaler les limites, etc. (ainsi par exemple du regard instruit jeté sur l’expérience Freinet de la banlieue de Lille par les chercheurs de l’université locale)
des conditions de travail qui permettent l’expérimentation, la concertation, l’échange et la circulation de l’information et de la réflexion. L’autonomie dont les enseignants ont besoin est en effet une autonomie collective, pas l’isolement de chacun dans sa classe. A eux, dans le cadre de cette autonomie, de prendre appui sur les chercheurs qui peuvent contribuer à l’observation réfléchie des pratiques, à valider les expériences novatrices, en signaler les limites, etc. (ainsi par exemple du regard instruit jeté sur l’expérience Freinet de la banlieue de Lille par les chercheurs de l’université locale)
![]() une formation initiale et continue qui leur assure une véritable maîtrise didactique de l’enseignement de leur discipline et les moyens intellectuels réels d’interroger leur propre pratique, dans un dialogue d’égal à égal avec les chercheurs (on pourra se reporter aux propositions du GRDS en ce domaine et à la discussion dont elles font l’objet).
une formation initiale et continue qui leur assure une véritable maîtrise didactique de l’enseignement de leur discipline et les moyens intellectuels réels d’interroger leur propre pratique, dans un dialogue d’égal à égal avec les chercheurs (on pourra se reporter aux propositions du GRDS en ce domaine et à la discussion dont elles font l’objet).
d/ Quatrième point : la détermination de la culture commune que l’on veut transmettre aux jeunes générations, au fil du parcours commun, ne relève ni des seuls enseignants, ni a fortiori des seuls experts en éducation, mais d’un débat très public, dont les enjeux essentiels doivent être largement et précisément explicités. On y retrouvera inévitablement quelques grands thèmes récurrents : la place des « disciplines », celle qu’il convient de faire aux « grandes œuvres », la modernisation des contenus, la fameuse « ouverture sur la vie », la spécificité incontournable des savoirs scolaires, etc. Avançons cette observation : si l’on admet le principe d’un tronc commun poursuivi au lycée (jusqu’en première ou en terminale), la culture qui y est transmise doit permettre toutes les orientations ultérieures. Son caractère de culture « générale » doit donc être pris au sérieux. Sachant que l’école a pour mission fondamentale et irremplaçable de permettre l’entrée dans la culture écrite, les piliers de cette dernière, la maîtrise de la langue écrite et celle du langage mathématique, doivent constituer le noyau dur de la culture transmise à tous par l’école. Mais celle-ci ne saurait se désintéresser des bases et des formes de la culture scientifique, de la culture technique, de la culture artistique, de la culture sportive…
A vos plumes !
Nous avons également ouvert une rubrique « expérimentations » où les collègues qui mettent en œuvre des pratiques d’enseignement visant à maintenir des ambitions élevées en matière d’apprentissages cognitifs avec les publics « difficiles » seront invités à en faire état.

